~ 0 ~
Prolégomènes
0.1 Préface
0.11 Objet de la métaphysique
La métaphysique, telle que nous la concevons dans ce journel, a peu à voir avec une philosophie, une doctrine, une croyance, une spiritualité, une idéologie, une science.
La métaphysique n’est rien d’autre qu’une grille d’analyse.
Le préfixe grec «Méta» signifie d’une part «au milieu de»; «dans le prolongement de» d’autre part.
La science, c’est la Physique.
La métaphysique tire de la Physique ses connaissances des principes, lois, déterminismes, contraintes constituant et gouvernant l’Univers d’une part.
D’autre part, dans le prolongement de ces notions et concepts empruntés à la Physique, elle élabore une grille d’analyse logique applicable à tout objet de connaissance.
Cette grille d’analyse logique sert d’encadrement généralisé à l’analyse d’objets de connaissance — autrement dit de paramètre.
Le présent article obéit à la logique de cette grille d’analyse.
0.12 Volets iconiques
Tout objet de connaissance constitue un icone comportant deux volets: binaire et contingentiel.
Le volet contingentiel s’avère parfois complémentaire de la binarité et parfois inversement.
On trouvera la notion de binarité en ce journel à l’adresse planitoilaire suivante:
0.13 Le vocabulaire en usage dans ce journel
Les objectifs visés par les lexiques du présent journel sont suffisamment expliqués dans l’article cité ci-dessous en 0.23. Les acceptions, notions et concepts élaborés en ce journel sont valables pour ce journel; ils ont pour objet de favoriser une compréhension mutuelle de l’auteur et des lecteurs au regard de la signification des termes utilisés.
0.2 Préalables
0.201 0 Présentation générale; 0.1 Le présent journel.
0.202 0 Présentation générale; 0.2 Symbolique du montage graphique.
0.203 00 Lexiques; Présentation générale.
0.204 00 Lexiques; 2 Lexiques et dictionnaires: usages et abusages
0.205 03 Le Petit Notionnaire; Présentation
0.206 03 Le Petit Notionnaire; Catégorie.
0.207 04 Le Grand Notionnaire: Présentation
0.208 04 Le Grand Notionnaire: Binarité
0.209 04 Le Grand Notionnaire; Catégories, stéréospécificité, stéréosélectivité
0.210 14 L’intentionnalité universelle.
0.3 Références
0.31 Les dictionnaires
A. Bailly, Abrégé du dictionnaire grec-français, Hachette, 2007.
F. Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Hachette, 2008
J. Dubois, Le Lexus -le dictionnaire érudit de la langue française, Larousse, 2009.
Le grand dictionnaire terminologique du Québec [GDT].
M.-E. De Villers, Multidictionnaire de la langue française, Québec Amérique, 2009.
P. Robert, Le Petit Robert, Le Robert, 2011.
R. Mortier, Dictionnaire Quillet de la langue française, Aristide Quillet.
0.32 Documents proposés
0.32.01 Wikipédia, Analogie métaphysique
0.32.02 Patrick Juignet, Philosophie, Science et Société, Substance
0.32.03 Futura science, Matière sombre
0.32.04 Le Big-bang: fondements et incertitudes scientifiques
0.32.05 Astronomie et Astrophysique
0.32.06 Principe d'incertitude
0.32.07 Deux, voire trois nouvelles particules pour LHCb
0.32.08 Dark Matter Day : qu'est-ce que la matière noire et l'énergie noire ?
0.32.09 Le Big Bang : Instant zéro ou "singularité initiale"
0.32.10 Big-Bang
0.32.11 Une critique de la cosmologie du big bang
0.32.12 Physique des particules
0.32.13 Études des champs scalaires et vectoriels
0.32.14 Champ de Higgs électrofaible
0.32.15 Masse manquante
0.32.16 Le cerveau, une centrale électrique
0.32.17 Qu'est-ce que les systèmes nerveux sympathique et parasympathique?
0.32.18 Greta Thunberg clapped back at Deutsche Bahn...
0.32.19 Trains bondés : La compagnie allemande de chemins de fer répond à Greta Thunberg
0.32.20 Greta Thunberg tells (...) "we will make sure we put world leaders against the wall"...
0.4 Terminologie
Binarité.
Le Petit Terminaire Le Grand Notionnaire
Catégorie.
Le Petit Terminaire Le Grand Notionnaire
Contingence.
Le Petit Terminaire
Idéonoêmie
Le Petit Terminaire
Journel.
Le Petit Terminaire.
Métaphysique.
Le Petit Terminaire
Nomies
Le Petit Terminaire
Néologisme.
Le Petit Terminaire
Néovocable.
Le Petit Terminaire
Notion
Le Petit Terminaire
Paralogisme
Le Petit Terminaire
Planitoile, planitoilaire
Le Petit Terminaire
Sensoir
Le Petit Terminaire
05 Les couleurs
Termes importants; À retenir; Définitions; Notes; Liens.
0.6 Introduction
05 Les couleurs
Termes importants; À retenir; Définitions; Notes; Liens.
0.6 Introduction
0.61 Distinctions préliminaires
Un concept se distingue d’une idée.
La notion définit et/ou décrit une représentation mentale réaliste (ou irréaliste) d’un objet – chose ou phénomène.
Idées de choses: éléphant, char d’assaut, humanoïde, galaxie, pizza, tarte aux pommes...
Idées de phénomènes: tempête, électricité, vagues, éclairs, béguin, crise de nerfs...
Le concept décrit une représentation simulée de la manière d’être ou du comportement d’un objet – chose ou phénomène. «E=MC2» simule le comportement d’un phénomène: la relativité.
Le concept se distingue de l’idée en cela qu’il constitue une interprétation des perceptions des objets réels sans nécessairement s’avérer en mesure de se les représenter sous une forme réaliste. Sans être réaliste, la représentation est adéquate, i.e. en adéquation avec l’objet réel de connaissance. Ou complètement inadéquate! On parle alors d’erreurs de calculs ou d’erreurs interprétatives.
0.62 Simulation et pensée symbolique
Binarité et contingencité représentent les deux manières d’être de tout objet de connaissance. En cela, ces notions sont parties constituantes de concepts. Les concepts sont le produit de la pensée symbolique. Ceci est expliqué dans l’article intitulé «04 Le Grand Notionnaire: Présentation», chapitre 1.36, dont on retrouve le lien ci-haut en 0.207.
On peut utiliser les microscopes les plus puissants, on ne verra jamais les concepts de hasard et de nécessité.
On peut utiliser les télescopes les plus puissants, on ne verra jamais le concept mathématique «E=MC2».
Cela parce qu’un concept ne représente rien de manière réaliste: il simule.
Tout cela est expliqué dans l’article intitulé «L’intentionnalité universelle», chapitre 1.1, lien en 0.210.
0.63 De l’analogie à la contingencité
Dans ce journel, nous dénommons «contingencité» ce que les anglophones dénomment «analogue».
Le vocable utilisé à l’échelle de la planète francophone est «analogue». Cet emploi est fautif à tous égards.
Selon l’acception grecque, une analogie désigne une proportion mathématique d’abord; une identité de rapports entre choses ou phénomènes d’autre part [Consulter lien en 0.32 .1 Analogie métaphysique. L’article parle d’analogie métaphysique mais de fait, il y est question de doctrines philosophiques qui débouchent sur des théologies. Nous ne sommes plus dans un contexte de grille d’analyse mais de supputations idéologiques].
Ce étant, l’analogie est une expression du principe d’identité et de ce fait appartient à l’ordre de la binarité. L’analogie ne peut s’avérer à la fois une catégorie parallèle à la binarité et s’avérer une sous-catégorie de la binarité. Ce qui contrevient au principe d’altérité [Cf 04 Terminologie, Catégorie, Le Grand Notionnaire].
Voilà pourquoi le terme “analogie” est banni du présent article.
0.64 La notion de contingencité
Pour former un concept, un vocable comme «contingence» doit d’abord se définir comme notion. Or une notion ne représente pas que des objets mentaux: elle représente également des sujets mentaux que l’on considère alors également comme objets de connaissance. Ces sujets mentaux doivent s’avérer en adéquation avec les objets mentaux; ces objets mentaux doivent s’avérer une reconstruction mentale adéquate – réaliste ou simulée – des objets réels. On obtient donc la boucle que voici: objet réel ⇨ objet mental ⇨ sujet mental ➔ objet mental ➔ objet réel. Le symbole ⇨ désigne les processus d’intellection de l’objet réel; ➔ désigne les processus d’adéquation à l’objet réel. Cette boucle obéit au principe d’adéquation au réel.
0.65 Le présent article
Le présent article comporte trois titres que voici:
Titre I La contingence: second volet de l’être universel;
Titre II Assises ontophysiques de la contingencité;
Titre III Apports à la grille d'analyse ontophysique;
Titre IV Épilogue.
~ I ~
LA CONTINGENCE
SECOND VOLET
DE L'ÊTRE UNIVERSEL
1.1 Grille d’analyse ontophysique
1.11 Objet de la métaphysique
Il importe d’abord de se rappeler quel est l’objet propre de la métaphysique.
La métaphysique n’est pas une science. Elle n’est pas une doctrine.
La science, c’est la physique. Dans le présent journel, nous ne considérons pas les études empiriques comme de nature scientifique. Tout au plus peut-on les qualifier de savoirs.
La Physique, fondamentalement, c’est l’ordre qui régit l’univers.
La métaphysique d’inspiration scientifique tire ses connaissances des données certifiées de la science: principes, lois universelles, contraintes, déterminismes, déterminations ainsi que les données de la cybernétique, de la physique traditionnelle [mécanique, optique etc], de la biologie, physiologie et autres domaines de la Physique.
Nous résumons tous ces données de la science sous le vocable «nomies».
1.11.2 La métaphysique: une grille d’analyse
Dans le prolongement des nomies tirées de la Physique, la métaphysique se définit ici comme une grille d’analyse dont l’objet est la compréhension de l’Être universel et de ses composantes.
Une grille d’analyse métaphysique n’est pas figée: elle évolue au rythme et au gré des connaissances scientifiques. Quand une grille d’analyse se mute en certitudes inexorables pour l’éternité, elle n’est plus grille d’analyse mais doctrine, idéologie, philosophie, dogme, croyance...
Notons que les idéologies de type spiritualité, ésotérisme, occultisme, hermétisme et autres se proclamant «métaphysiques» ne sont de fait que charlatanismes. Rien dans la définition du vocable et dans l’histoire de la métaphysique ne peut justifier leurs prétentions.
1.2 Structure iconique triptyque des objets mentaux.
1.21 La perception humaine
Ce que nous connaissons des objets réels se limite à ce que nos sensoirs en perçoivent. Or nos perceptions sont balisées par nos besoins de connaissances liées à notre survie. Nos sensoirs transforment les configurations des objets réels en signes et signaux codés que le cerveau décode et reconstruit. Les objets réels ainsi reconstruits constituent des objets mentaux.
1.22 Structure iconique des objets mentaux
Tout objet mental constitue un icone triptyque composé de deux volets: l’un contingentiel, l’autre binaire.
Le tableau que voici:
Le tableau simule la manière d’être des objets mentaux. Cette structure iconique s’inspire de la construction des icones de l’orthodoxie chrétienne orientale.
Tout objet mental est triptyque, constituant un icone [en ce sens au masculin] doté de deux volets: binaire et contingentiel.
L’icone est une représentation abstraite du réel, et relationnelle à cet objet réel.
Note: par abstrait, nous entendons ce que nous avons décrit en 1.21 ci-devant.
1.3 L’ontophysique
1.31 Quelques définitions
Voici quelques définitions pertinentes quoique succinctes:
1.31.1 La Physique: qu’est-ce?
La Physique, essentiellement, c’est l’ordre qui régit l’univers.
1.31.2 L’ontophysique: qu’est-ce?
L’ontophysique, fondamentalement, c’est l’étude de l’Être de tout ce qui est, de l’Être dit universel et de ses composantes.
L’ontophysique est un concept triptyque. Le tableau que voici:
1.32 Les composantes de l’ontophysique
L’ontophysique est un concept triptyque comportant un volet binaire – l’ontomorphie – et un volet contingentiel – l’ontologie. Pour Aristote et les péripatéticiens, on appelait “ontologie” ce que nous appelons en ce journel “ontophysique”. C’est que nous réservons le vocable “ontologique” au volet contingentiel de l’ontophysique.
1.32.1 L’ontomorphie
L’ontomorphie réfère au volet structurel et formel de l’Être universel et de ses composantes. Ce volet inclut les notions de formes, structures, catégories et autres notions de type binaire.
1.32.2 L’ontologie
L’ontologie réfère au volet organisationnel et relationnel de l’Être universel et de ses composantes.
Le grec «logia» désignait la parole mais beaucoup plus que simplement la parole. La parole est un mode relationnel, un système communicationnel, l’accent étant mis sur la communication.
Les «logies» réfèrent dans cette grille d’analyse à tout ce qui est relations, rapports, interactions, communications, systèmes, fonctionnements, processus, bref organisations.
L’ontologie est de type contingentiel.
1.33 Assises de la grille d’analyse ontophysique
1.33.1 Approche épistémologique
Nous sommes ici dans une branche de la métaphysique appelée «épistémologie». Ce vocable vient du grec en passant par l’allemand et l’anglais.
Le vocable est composé de deux mots grecs: «épistêmê» et «logia». «Épistêmê» signifie «savoir» et «logia» se réfère aux «logies» dont nous avons causé à l’alinéa précédent.
L’épistémologie constitue une grille rationnelle qui permet l’analyse des études scientifiques et empiriques, analyse qui aboutit sur la (non-)validation de ces études, recherches, travaux de laboratoires etc.
Voyons le contenu de cette grille de plus près.
1.33.2 Présentation du tableau
Le tableau que voici, que nous allons commenter ci-après:
1.4 La notion contingentielle d’ordre
1.41 La notion d’ordre
1.41.1 Origine du vocable
Le vocable «ordre» vient du latin «ordo», signifiant “rangée”, “rang”, ligne d’une part; succession d’autre part.
La généralisation des acceptions du terme est empruntée à l’art de tisser les fils. Un tissus est un ensemble de fils constitués en rangs, en rangées successives, bref dans un ordre bien défini.
1.41.2 Acception métaphorique du vocable
Un tissus crée un objet réel que nous appelons en ontophysique un «Étant». Un «Étant» n’est pas un objet potentiel mais un objet actué, chose ou phénomène.
Un tissus est également une manière d’être créée par le tissage, manière d’être qui prend nom de «Étance».
Tout ordre est conséquemment une «Étance», soit une manière d’être, une manière d’agir, de se comporter, d’évoluer dans toutes les dimensions. sphères et composantes de l’Univers.
Quand on dit que la Physique est l’Ordre qui régit l’Univers, c’est à cette notion d’ordre que l’on se réfère.
Parce que tout ordre est relatif à la nature des objets réels qu’il régit, l’ordre appartient dès lors au domaine de la contingencité.
1.41.3 Rappel de la notion de «Nomies»
Comme les lecteur(e)s ont probablement oublié la définition que nous avons donnée des «nomies» en 1.11.1, petit rappel succinct.
Par «nomies», nous entendons ici l’ensemble des principes, lois universelles, contraintes, déterminismes, déterminations régissant tous les êtres de l’univers. Les nomies constituent un ordre de réalités comportant quatre sous-ordres: typonomie; kinètonomie; téléonomie; déontonomie.
Chaque sous-ordre constitue un icone comportant un volet binaire et un volet contingentiel.
En somme, par nomies, on entend l’ensemble des lois naturelles régissant les êtres de nature, les «Étants» dans notre jargon. Les lois naturelles assurent la viabilité de l’Univers et de ses composantes. Elles régissent les choses et les phénomènes ainsi que la biosphère.
Au sein de la biosphère retrouve-t-on les humains.
Chez les humains, les lois naturelles fondent les droits humains. L’observance et le respect des droits humains ont priorité sur toutes lois et législations établies par les États, ainsi que sur les diktats de toutes formes d’organisations et organismes, incluant les organisations religieuses.
1.42 Sous-Ordre téléonomique
1.42.1 Le tableau
Le tableau illustre les rapports iconiques téléonomiques:
le volet contingentiel complémentaire (système): les causes finales;
le volet binaire dominant (mécanismes): les mécanismes de conservation.
1.42.2 Notion de téléonomie
Ce terme est formé de deux mots grecs: «téléos» et «nomos».
«Nomos» donne «Nomie» dont nous avons suffisamment précisé les acceptions.
«Téléos» induit l’idée de finalité, idée s’appliquant à une multitude de réalités.
La notion comporte un volet binaire: les mécanismes, fonctions, processeurs impliqués; un volet contingentiel: les systèmes, fonctionnements, processus impliqués.
1.42.3 Objet de la téléonomie
Par «téléonomie», nous entendons ici l’ensemble des principes, lois universelles, contraintes, déterminismes, déterminations régissant la finalité de tous les êtres de l’univers. La finalité de l’Univers et des Étants qui le compose est relative à chaque niveau d’Étance:
-) L’Univers: la pérennité.
-) Les choses matérielles et les phénomènes énergétiques: la durée.
-) La biosphère: la survie – laquelle sous-entend la nécessaire viabilité des êtres vivants.
Chez les humains, par survie, entend-on la préservation, la défense, la promotion, le développement, l’épanouissement de l’intégrité physique de la personne.
Par intégrité de la personne, on entend son intégrité somatique, psychique, psychologique, psychosociale, socioéconomique.
Le non-respect du sous-ordre téléonomique est fauteur de désordre.
1.43 Sous-Ordre déontonomique
1.43.1 Le tableau
Le tableau illustre les rapports iconiques déontonomiques:
le volet contingentiel dominant (système): les causes matérielles (processus d’adaptation);
le volet binaire complémentaire (mécanismes): les mécanismes d’oscillation.
1.43.2 Notion de déontonomie
Ce terme est formé de trois mots grecs: «de», «ontos» et «nomos».
«Nomos» donne «Nomie» dont nous avons suffisamment précisé les acceptions.
«De», impératif grec signifiant «il faut», induit les idées de contrainte, de nécessité, idées s’appliquant à une multitude de réalités.
«Onto», du grec «ontos», signifie “ce qui est”: choses ou phénomènes (Étants); manière d’être, d’agir de ces choses ou phénomènes (Étances).
1.43.3 Objet de la déontonomie
Par «déontonomie», nous entendons ici l’ensemble des principes, lois universelles, contraintes, déterminismes, déterminations régissant la viabilité de tous les êtres de l’univers. La viabilité de l’Univers et des Étants qui le compose est relative à chaque niveau d’Étance:
-) Les aliments. Tous les Étants requièrent matière et énergie pour fonctionner. Fonctionner est un travail qui entraîne dépense d’énergie et perte de masse, qu’il faut récupérer pour continuer de fonctionner. Sinon, c’est le dépérissement progressif. C’est vrai des astres. C’est vrai des humains.
-) La migration. La concentration massive d’Étants dans un territoire restreint défavorise la viabilité des iceux. La concentration d’objets matériels favorise les collisions car tout objet de la nature est mouvement. La surconcentration d’humains dans un territoire restreint mène à des conflits.
La migration est une contrainte au niveau de l’univers qui est en expansion; elle est contrainte au niveau de la biosphère: les bactéries et virus migrent; les végétaux migrent; les animaux migrent; les humains migrent...
-) L’acclimatation. Tout objet, chose ou phénomène, doit s’acclimater à son environnement immédiat pour s’avérer viable. L’acclimatation permet de s’ajuster et de fonctionner de manière appropriée, notamment en développant des organes, des outils, des fonctionnements adaptatifs.
Ce sont des mécanismes d’oscillation “excités” par des stresseurs qui forcent l’adaptation de l’objet à son environnement. Quand ces mécanismes se dérèglent, un processus s’engage – mésadaptation – pour finalement aboutir sur un dysfonctionnement complet – inadaptation.
Chez les humains, par viabilité, entend-on le maintien et l’assurance de la qualité d’existence des humains.
Cette tendance innée à la viabilité existentielle est régie par l’instinct humain. Cette tendance à la viabilité constitue rien de moins qu’un droit naturel: droit naturel aux aliments, à la migration, à l’intégration à son milieu. Par aliments, doit-on entendre la nourriture, l’habillement, le logement.
Ces droits naturels ont priorité sur les droits reconnus par les États et fondent les droits humains.
Le non-respect du sous-ordre déontonomique est fauteur de désordre.
1.44 Sous-Ordre typonomique
1.44.1 Le tableau
Le tableau illustre les rapports iconiques typonomiques:
le volet contingentiel complémentaire (système): les causes formelles (processus de morphogenèse);
le volet binaire dominant (mécanismes): autodétermination structurelle des objets.
1.44.2 Notion de typonomie
Ce terme est formé de deux mots grecs: «typos» et «nomos».
«Nomos» donne «Nomie» dont nous avons suffisamment précisé les acceptions.
«Tupos» réfère d’abord à une empreinte, d’où de multiples significations dérivées. Désigne des caractères gravés, donc à l’époque, des signes d’écriture. Par extension, des formes, des images, des gravures, ébauches, plans, esquisses... La représentation générale d’un objet.
En latin et par la suite dans les langues occidentales, le “Y” fait place au “U”. Devrait de fait s’appeler «U grec». C’est que les Latins comme les anglophones de nos jours sont incapables de prononcer un “U” autrement que “OU”.
Chez les Latins et ultérieurement les Occidentaux dont les francophones, le vocable en est venu à signifier “Modèle”.
En contexte métaphysique, il est question des caractéristiques fondamentales déterminant le modèle des “Étants” et des “Étances”. Autrement dit, les types d’êtres et de manières d’être.
Le modèle régit l’émergence, le développement, l’évolution d’un objet, ce que nous dénommons «morphogenèse».
Cette morphogenèse n’est pas régie par des agents extrinsèques aux objets mais intrinsèques aux iceux, relevant d’un mécanisme d’autodétermination. Ce qui disqualifie de nombreuses croyances dont nous ne discuterons pas ici.
1.44.3 Objet de la typonomie
La typonomie a pour objet de déterminer la constitution et la configuration de tout objet présent dans l’univers.
-) Substrat. Par substrat, entendons un quantum de matière/énergie déterminé par des prédispositions que l’on peut comparer à des programmes opérationnels. Par exemple, la génétique chez les animaux.
-) Archétype. Il s’agit de manières d’être et d’agir prédéterminées par la nature spécifique d’un objet. Il s’agit de types d’être inhérents à l’objet et non transmis par des agents étrangers à l’objet spécifique.
La typonomie détermine l’être de la personne.
L’existence est un don parental. Merci les parents! Une fois la conscience de soi de l’individu acquise, l’existence de la personne appartient à cette personne et à nulle autre.
-) Le choix entre la vie et la mort appartient à la personne propriétaire de sa vie et à nulle autre. Dès que la conscience de soi de l’individu est présente, la morphogenèse de sa vie lui appartient.
-) Même si la servitude et l’esclavage sont pratiqués chez certains insectes sociaux, ces pratiques portent atteinte à l’intégrité physique de la personne et constituent une violation du droit à l’autodétermination de la personne.
Il importe ici de distinguer les «droits» des «libertés».
Les droits civiques découlent des droits humains et ne peuvent être restreints d’aucune manière.
Les libertés civiques sont des permissivités qui peuvent être restreintes en certains contextes légitimes.
Le non-respect du sous-ordre typonomique est fauteur de désordre.
1.45 Sous-Ordre kinètonomique ou autonomique
1.45.1 Le tableau
Le tableau illustre les rapports iconiques autonomiques:
le volet contingentiel dominant (système): les causes efficientes (processus cybernétiques);
le volet binaire complémentaire (mécanismes):l’autogouvernance autarcique.
1.45.2 Notion de kinètonomie ou autonomie
Autonomie est formé de deux mots grecs: «autos» et «nomos».
«Nomos» donne «Nomie» dont nous avons suffisamment précisé les acceptions.
«Autos». Le grec signifie «même». Comme dans “ici même”, “moi-même” etc. En certains contextes, prend la même acception que «monos» [seul], d’où le français «même». Acception retenue: «de lui-même, d’elle-même».
En français moderne, le vocable est devenu une sorte d’adverbe préfixe induisant les idées de fonctionnement par soi-même, de soi-même. Qui dit fonctionnement dit mouvance, conduite de la mouvance d’où le lien intrinsèque avec la cybernétique. Le préfixe «kinèto» fait référence au mouvement.
La kinètonomie a pour objet la gouvernance de tout ce qui se meut avec autonomie dans l’Univers – choses et phénomènes, régissant la manière dont les Étants se meuvent.
-) Autorégulation. Tout objet tend à maintenir une certaine homéostasie. Un mécanisme d’oscillation inhérent aux objets assure le maintien de cette homéostasie.
-) Autarcie. Ces mécanismes oscillatoires et de façon plus générale de gouvernance de la mouvance des objets réels sont régis par des structures inhérentes à ces objets, et non le fruit d’agents externes.
On va arguer que des conditions externes vont générer des modifications de la température, modifications des processus atmosphériques. Donc des agents externes peuvent être causes de mouvances.
Or il n’en est rien. L’atmosphère est un objet réel régi par ses mécanismes internes. El Nino et La Nina sont des phénomènes autarciques et autorégulés. Les défis pour les physiciens sont d’en découvrir toutes les règles.
L’autonomie régit la mouvance des personnes. Dans la nature, l’autonomie des objets réels est régie par les forces centripètes et centrifuges, ainsi que par le rapport de forces entre ces deux contraintes. L’autarcie des objets réels est par conséquent régie par les conditions affectant la mouvance des objets réels, incluant les humains.
Dans la nature, dans l’univers, l’autonomie absolue n’existe pas, sauf pour l’Univers soi-même. Et même là, l’Univers est gouverné par ses propres principes et lois internes, absolument contraignants.
La possibilité de jouir d’une vie personnelle constitue un droit fondamental. Les manières de vivre cette vie personnelle sont toutefois dépendantes de nombreux épifacteurs [facteurs hasardiques modifiant les facteurs fondamentaux]: la société, l’environnement, les possibilités réelles, les contraintes économiques, l’harmonisation entre ses libertés et celles d’autrui notamment et non exclusivement.
Les libertés s’avèrent donc balisées par les divers contextes. Ces balises sont d’abord naturelles, mais également sociales. Un(e) criminel(le) invétéré(e) s’avérant toxique pour l’ensemble d’une société — et par société, entendons l’ensemble des citoyens résidant sur un territoire donné — peut voir ses libertés de mouvements maximalement réduits. On ne peut cependant porter atteinte à son droit à la vie. Si tel(le)s criminel(le)s se croient victimes d’ostracisme, n’ont qu’à s’en prendre à eux/elles-mêmes.
1.46 Liens entre ordre et organisations
1.46.1 Nomies, ordre, organisation, contingencité
Tout, dans l’Univers, est régi par les mêmes principes, lois, forces, contraintes, déterminismes, systèmes, organisations, structures, interactions et autres... Ce que nous appelons en ce journel «Nomies».
Tout donc est régi par les mêmes nomies... RELATIVEMENT!
Que veut-on signifier par “relativement”? Tout dépend de l’ordre qui régit toutes choses et phénomènes du point de vue de leurs organisations. Or comme il s’agit d’ordres similairement différents ou différemment similaires, cette diversité nous plonge dans les profondeurs abyssales de la contingencité.
L’ordre exprime les systèmes organisationnels régissant les manières d’être et d’agir des objets de connaissance – choses ou phénomènes.
Les organisations sont des manières d’être et d’opérer: systèmes, processus, fonctionnements...
En ce journel, nous reconnaissons quatre nomies. Les rapports entre ces quatre nomies s’organisent comme suit:
Les nomies sont essentiellement des causalités. Nous reconnaissons ici quatre modèles causals: kinètonomie, typonomie, téléonomie, déontonomie.
Deux modèles sont de type structurel: autonomie et typonomie.
Deux modèles sont de type organisationnel: téléonomie et déontonomie.
Les modèles structurels DÉTERMINENT la nature des objets réels.
Les modèles organisationnels RÉGISSENT les manières d’être et d’agir des objets réels.
Les modèles organisationnels ont valeur de prévalence sur les modèles structurels.
La typonomie forme une paire [volet binaire] avec la kinètonomie [volet contingentiel].
En cet univers, tout est mouvement. Rien n’existe qui ne soit mouvement.
La kinètonomie gouverne le mouvement de toute ce qui existe... RELATIVEMENT!
Pourquoi relativement? Parce que le mouvement est déterminé par la typonomie propre à chaque entité meublant l’Univers. Chaque entité se voit attribuer une morphogenèse spécifique: initiation, émergence, développement, expansion, décroissance, effondrement, disparition.
1.46.3 Modèles organisationnels
La téléonomie forme une paire [volet binaire] avec la déontonomie [volet contingentiel].
Tout ce qui est requis à l’initiation, émergence, au développement, à l’expansion d’une entité est régi par une cause finale contraignante: la pérennité pour l’Univers, la durée pour les choses et phénomènes, ce qui équivaut à la survie pour la biosphère.
1.46.4 Interactions entre modèles
Tout mouvement est régi par la téléonomie.
Les nécessités déontonomiques liées à l’existence d’une entité sont déterminées par la typonomie de cette entité.
1.5 La notion binaire de catégorie
Revenons au tableau inséré en 1.33.2.
On y retrouve la notion binaire de catégorie constituant, avec la notion d’ordre, un déterminant majeur de la grille d’analyse.
La notion de catégorie spécifie le modèle de structures qui caractérise un objet réel, du moins tel que perçu et reconstitué par l’intellect humain [voir ci-bas 1.6].
1.51 Notion succincte de catégorie
1.51.1 Fausse origine du terme
Cette notion est d’origine essentiellement aristotélicienne. Elle viendrait du grec «katègoria» (κατηγορία). Le problème: ce vocable grec signifie «accusation». Rien à voir avec les catégories.
Je discute de cette question dans le Petit Terminaire, lien 0.4.
Je postule que le terme grec authentique est «catègoridza».
L’acception de premier niveau que nous retenons dans ce journel:
«Qui se rattache structurellement à la racine, à la source de l’objet».
L’acception lexicographique que nous retenons:
Collection d’objets — choses ou phénomènes — de même nature.
1.52 Les catégories androterriennes
1.52.1 Les catégories aristotéliciennes
Les catégories aristotéliciennes comportaient les éléments suivants: substance (ou essence), quantité, qualité, relation, lieu, temps, position, possession, action, passion.
De fait, nous ne conservons que le concept de relation, au coeur de la cybernétique et par extension, de la cybermétaphysique et de l’ontophysique.
1.52.2 Les catégories androterriennes
Les catégories constituent une classe de réalités divisibles en sous-catégories, en sous-sous-catégories etc.
Ces catégories et sous-catégories peuvent emprunter deux formes: stéréospécificité et stéréosélectivité.
On trouvera la description de ces notions dans le Grand Notionnaire, CATÉGORIE, chapitres 1.2 et 1.3.
Au chapitre 1.4, on y explique également les liens entre catégorie et nomies.
1.53 Liens entre catégories et structures
1.53.1 Liens logiques
Toute structure l’est d’une catégorie spécifique d’objets, choses ou phénomènes. Il s’agit d’un lien logique constitutif de la nature propre des structures. Toute structure l’est d’une catégorie d’être.
1.53.2 Liens entre structures, stéréospécificité et stéréosélectivité
La structure détermine la manière d’être d’un objet réel mais également sa manière d’opérer. Cette manière d’opérer sera de type stéréospécifique ou stéréosélectif.
1.54 Notions de structure, de forme, d’objet réel
1.54.1 Système perceptif
Quand nous pensons «chameau», nous n’avons pas cet objet de connaissance réel dans le cerveau.
Quand nous pensons «tempête de neige», nous ne subissons pas ce phénomène réel dans nos cerveaux.
Nos sensoirs appréhendent les formes perceptibles de ces objets – choses ou phénomènes – qu’ils transforment en signaux codés que nous appelons «données». Ces données sont acheminées au cerveau; le volet reptilien pour le traitement affectif et émotif de ces données; le volet intellectif pour le traitement intellectuel et jugementiel de ces données.
1.54.2 Système intellectif
Le cerveau intellectif reconstruit l’objet réel pour former l’objet mental. Cet objet mental représente donc de manière réaliste les formes des entités – choses ou phénomènes; il représente également en les simulant les manières d’être et d’agir de ces entités – choses ou phénomènes.
Tous les vivants perçoivent les objets réels dans une mesure déterminée par leur nature propre. La vision qu’ont les abeilles ou les taons d’une rose diffère de celle des humains. Les chats ont une perception dans l’infrarouge dont ne jouissent pas les humains. La vision de tous les vivants est partielle et déterminée par les exigences liées à leurs survies [téléonomie], à leurs adaptations à l’environnement [déontonomie].
La réalité pour les humains correspond dès lors à la perception des objets réels qui est leur et n’englobe pas l’entièreté de l’être des objets réels.
Ce que les sensoirs perçoivent se limite aux configurations qui leur sont accessibles.
1.6 Macrostructures et entités
Les macrostructures sont les volets des structures qui définissent la manière d’être des entités.
1.61 Notion d’entité
On dénomme «entité» une portion de puissance actuée.
Le vocable s’origine du participe présent du verbe être latin «ens, entis». Le radical est «ent» auquel s’annexe le suffixe «ité» induisant les idées de manière d’être, d’état, de qualité, de caractéristiques, traits de caractère.
1.62 Notion de macrostructure
Ensemble des structures principales d’une entité.
La macrostructure d’une maison par exemple désigne les fondations, la charpente, les divisions, la maçonnerie, la plomberie, le réseau électrique, etc.
La macrostructure d’un humain désigne le somatique.
1.7 Infrastructures et organisation
On dénomme «organisation» les systèmes, fonctionnements, processus régis par leurs infrastructures propres.
1.71 Notion d’organisation
Le terme «organisation» a d’abord signifié un objet organisé – chose ou phénomène, une entité. En ce sens, l’histoire lui a substitué «organisme». Un tel usage cependant subsiste toujours dans des expressions telles organisation sociale, organisation politique et autres. En tels cas devrait-on parler d’organismes sociaux, politiques et autres.
Le suffixe «isation» induit l’idée de transformation, donc de système, de processus, de fonctionnement.
Une organisation réfère donc à un organe générateur de systèmes, de processus, de fonctionnements, de transformations.
Il désigne également le produit d’un système, processus, fonctionnement.
Comme tant les processus que les résultats sont aléatoires, variables, conditionnels, toute organisation est d’ordre contingentiel.
1.72 Notion d’infrastructure
Ce mot est composé du préfixe «infra» et de structure.
Le préfixe «infra» induit l’idée de ce qui se trouve dessous, avec idée de positionnement d’une part.
À l’origine s’agissait-il des installations inférieures à toutes structures, qui servent de soutènement aux structures. Cette dernière acception – soutènement aux structures – permet un usage analogique du terme.
L’infrastructure désigne alors l’organe, la logistique, le volet bref de toutes structures qui permet de régir toutes formes d’organisations. L’infrastructure régit l’organisation.
Dans une maison, ce sera le système électrique, la gestion de l'eau et des renvois, voire la domotique par exemple.
Chez l’humain, c’est le psychique.
1.73 Infrastructure et organisation
Par organisation, on entend le processus par lequel une manière d’être, d’évoluer, d’agir s’implante, se modifie, se transforme pour aboutir à un état de fait: l’organisation comme produit.
L’infrastructure y joue son rôle: structurer le processus et les résultats.
1.8 Approche ontophysique
1.81 De la cybermétaphysique à l’ontophysique
Jusqu’ici, nous avons cheminé en contexte cybermétaphysique. La même grille peut s’exprimer en contexte ontophysique. Reprenons brièvement notre cheminement.
1.82 Les modes de représentations mentales
1.82.1 La perception
Révisons les mêmes constats:
Quand nous regardons une voiture, un cheval, un char d’assaut, la lune, une pizza, un(e) humanoïde et autres, nous n’absorbons pas la totalité de ces objets réels dans nos cerveaux, ne fut-ce que par manque de place.
Quand nous écoutons un concerto pour violon de Mozart, les nouvelles de fins de soirée, les discours abracadabrants de Trump, nous n’avons pas le violon, la télévision ou Trump [heureusement] dans le cerveau.
Nos sensoirs ne captent que les configurations essentielles à notre survie et la viabilité de nos existences.
Ces perceptions sont traduites en signaux sous la houlette de codes prédéterminés.
Ces signaux sont transmis au cerveau reptilien via le système réticulaire ascendant, générant des effets affectifs variés. Le système réticulaire intègre les réseaux nerveux perceptifs et moteurs.
Ce même système réticulaire dirige également ces données vers le cerveau attelé au cerveau reptilien, sous la gouverne d’une faculté ou processeur que nous appelons intellect.
C’est là, sous la conduite de l'intellect, que les configurations des objets perçues sont reconstruites. Le cerveau humain est représentationniste et constructiviste.
Le cerveau humain est également associationniste. L’intellect va graver des données dans des molécules logées dans les protoplasmes des neurones pour former la mémoire long terme. Existent également une mémoire vive liée au cerveau reptilien – un peu comme les barrettes d’un ordinateur – et une mémoire tampon – comme sur les disques durs d’un ordinateur: quand les barrettes sont pleines, les données non immédiatement utilisées sont déplacées vers cette mémoire tampon sise sur le disque dur. Un phénomène similaire se produit mentalement.
Les synapses dont les champs électriques circulent pratiquement à la vitesse de la lumière assurent les liens entre ces données, quand ces liens sont nécessités.
Pas tous les cerveaux sont hyperperformants. Les performances sont traduites en résultats de 00 à 200 sur la courbe de Bell ou de 1 à 9 si on utilise le modèle des stanines.
Ce qui va retenir notre attention, ce sont les modes de représentation.
L’intellect produit deux types de représentation des objets réels, pour former les objets mentaux: la représentation réaliste; la représentation simulée.
Le tableau que voici:
Les représentations réalistes génèrent les idées.
Le mot «idée» vient du grec «eidos» qui veut dire «image», «représentation réaliste d’objets».
Les représentations simulées génèrent les concepts.
Le vocable vient du latin, tiré du participe passé [conceptus] du verbe concevoir [concipere].
Descartes, Kant et plusieurs autres idéologues ont proposé leurs définitions du vocable. Nous n’en retenons aucunes.
Dans ce journel, un concept est une représentation qui conçoit par simulation les manières d’être et de se comporter des objets réels qu’elle simule. Ainsi, E=MC2 est un concept simulant le comportement de la gravité.
Les mathématiques sont meublées de concepts qui simulent le Réel. Par simulation, on pourrait entendre une représentation fallacieuse du Réel. Si c’était le cas, la physique, les technologies, la construction et le contrôle des engins interspaciaux auraient tout faux. Mais semblerait que non...
Le tableau ci-devant est un concept faisant appel à des notions. Il simule le produit des représentations des objets mentaux généré par les activités du cerveau.
La notion est une idée développée. Elle doit permettre de se faire une idée réaliste et validée d’un objet mental. Si je désire décrire un éléphant, je ne vais pas éructer quelque chose comme «xy=az x xy2 ≤abz≡dvq≥0pwz»...
Ainsi, la Systémique est une approche scientifique du Réel par concepts mathématiques. Qu’on nous traduise en concepts mathématiques la notion de racisme systémique! Exemple d’utilisation absurde d’un vocable par des ignares qui se prennent pour de grand(e)s connaisseur(e)s!
Bref, la notion décrivant un éléphant doit faire image et s’avérer représentation réaliste ou ne pas être.
Toutes notions doivent également décrire de manière réaliste et plausible toutes idées subjectives que l’on se fasse d’un objet réel. Elles doivent décrire, définir à la fois les objets mentaux et les sujets mentaux.
1.83 La forme: un concept
1.83.1 La forme: représentation mentale
Le vocable jouit d’une vocation historique schizogénique: vocation populaire et vocation métaphysique. Nous allons évidemment nous attarder à sa signification métaphysique.
Il s’origine du latin – forma – lequel s’origine du grec dorien, un dialecte du grec à l’époque international avec l’ionien, l’éolien et autres dialectes. Le grec classique, c’est l’Attique et sa capitale Athènes. Le dorien était présent dans le Sud de l’Italie et en Sicile avant l’émergence de Rome.
En grec attique, «forme» s’écrit «morfè». En grec dorien, le même vocable s’écrit «morfa».
Le dorien a contribué à la formation du lexique latin. Sauf que ce dialecte a interverti deux consonnes: «m» et «f» pour «forma» au lieu de «morfa». Ce petit jeu a nom de métathèse.
Le substantif grec véhicule les acceptions suivantes: figure, configuration, apparence, sorte, espèce.
Le verbe donne une meilleure idée du sens de ce vocable: figurer, représenter.
En latin comme en grec, la forme est essentiellement une représentation.
Aristote cependant va un peu plus loin. La forme est la représentation du principe d’unité des êtres. Qu’est-ce à dire?
La forme détermine la nature propre des êtres, leurs propriétés d’une part; détermine leurs fonctionnements spécifiques d’autre part. C’est ce qu’Aristote dénomme «causes formelles».
Que l’âme soit la forme du corps est une notion aristotélicienne.
Aristote a introduit solennellement la notion de forme dans la métaphysique. La notion fut galvaudée mais n’en est jamais ressortie.
Le latin populaire reprend essentiellement les mêmes significations que le grec. Le vocable a cependant été récupéré par les métaphysiciens scolastiques qui ont travaillé fort pour lui attribuer une acception acceptable aux yeux de l’Église catholique.
1.83.4 L’époque moderne
Il y eut Kant et ses disciples qui ont récupéré la notion de forme à leurs manières, toujours enseignées dans certaines facultés de philosophie. Nous n’adhérons pas ici à ce qui nous apparaît davantage une doctrine bunkérisée qu’une grille d’analyse.
Au milieu du siècle dernier a émergé la «Théorie de la forme», laquelle a donné naissance au structuralisme. Jacques Lacan, psychiatre et métaphysicien, fut le principal porte-étendard francophone du structuralisme européen.
1.83.5 Notre concept de forme
Nous abordons cette particularité au chapitre suivant.
1.9 Assises ontophysiques
1.91 La double existence des êtres de nature
Le tableau que voici:
1.91.1 Êtres potentiels et objets actués/activés
Les êtres de nature meublant l’univers sont de deux ordres: actués (objets matériels) et activés (phénomènes énergétiques) d’une part; non actués/activés d’autre part.
Les êtres non actués/activés sont des êtres en puissance. Les êtres en puissance existent [voir 1,99].
Ainsi, des éléphants macroscopiques de la grandeur équivalant 100 000 fois notre soleil, se baladant dans l’espace interstellaire d’une galaxie à l’autre, de tels êtres n’existent pas parce que ne peuvent (puissance) exister.
Par contre un éléphant terrestre existe parce que peut potentiellement exister.
Nous définissons la notion de puissance plus bas.
Par «êtres potentiels», entendons que tout ce qui existe, existe parce que peut exister. Autrement n’existerait pas.
Les êtres qui n’existent pas, n’existent pas parce que potentiellement ne peuvent exister.
Fondamentalement, les possibles sont constitués de matière / énergie à l’état brut, non déterminés. Étalés dans le temps, des principes inhérents à l’Être universel vont déterminer progressivement des segments de cette matière / énergie pour ainsi constituer des objets tangibles.
Par principes, nous entendons deux modèles causals que l’on peut distinguer mais qui opèrent en symbiose: les causalités efficientes qui font bouger les choses; les causalités formelles qui déterminent les types d’objets ainsi créés.
Causalités formelles = typonomie (1.44);
Causalités efficientes = kinètonomie (1.45).
Ces deux causalités sont de l’ordre de la morphogenèse.
Téléonomie et déontonomie sont de l’ordre des propriétés.
1.91.2 Les êtres actués
Les êtres actués nous deviennent présents à l’esprit en tant qu’objets réels de connaissance. Ils comportent un volet binaire – Étants – et un volet contingentiel – Étances.
Par Étants, on désigne des types d’êtres, choses ou phénomènes.
Par Étance, on désigne les manières d’être: systèmes, fonctionnements, qualités, etc.
Notons que des objets considérés comme des Étants tangibles d’un certain point de vue peuvent s’avérer des néants à d’autres égards. Il en est ainsi des cabinets ministériels canadiens qui s’avèrent des néants constitutionnels mais des Étants gouvernementaux tangibles. C’est que l’on se réfère alors à des catégories de réalités distinctes.
1.92 Le Khaos
Le Khaos est à considérer comme l’assise fondamentale de la Contingencité. La contingencité est foncièrement et basiquement Khaosique.
1.92.1 De Khéos et de Khaos
Le vocable grec «Khéos» n’existe pas vraiment. Il est de nos jours encore utilisé pour signifier une charge, une dette. Le verbe «Khéô» existait, signifiant répandre des choses, des objets de manière éparpillée, confusément.
L’intérêt de ce verbe porte sur le fait qu’il a influencé le mot «Khaos» et son verbe «Khaô».
Chez les Grecs de l’antiquité, le Khaos désignait l’état de non-organisation qui existait avant la création de l’univers. Le Khaos, c’est l’immensité indéterminée de l’Univers.
Déjà chez les Grecs est apparue la confusion entre Khéos et Khaos, véhiculant l’idée d’une certaine désorganisation, d’une situation genre “bordélique”.
Le latin a conservé cette idée de désordre. Les langues occidentales ont suivi. Le chaos, c’est le désordre total.
1.92.2 Notion de Khaos
Le Khaos, c’est l’État flou, indéterminé existant avant l’émergence du monde organisé. Il est par sa nature propre infini et intégral. Il englobe tout le substrat que contient l’Être universel.
Notre grille d’analyse établit que le Khaos comporte deux volets constitutifs: la relation et la puissance.
1.92.3 Notion métaphysique de relation
Le vocable francophone vient du latin «relatio», lequel est un dérivé du supin du verbe «referre». L’idée fondamentale du vocable induit l’idée d’apporter, de rapporter. Par extension, l’idée de rapport à, rapport de... Cette idée de rapport sera adoptée par la métaphysique péripatéticienne et scolastique.
Le verbe latin est un terme composé d’un mot – ferre, auquel se fixe un préfixe – re. L’acception propre est «porter». Ce vocable reçoit cependant moult acceptions au figuré: comporter; mettre en mouvement; se porter au devant de, à la rencontre de; diriger, mener.
Nous retenons les idées de mouvement, de liens établis entre.
Le mouvement s’inscrit essentiellement dans l’espace et le temps. Les liens entre espace et temps sont au coeur de la relation.
La relation khaosique est indéterminée, par conséquent infinie.
Espace et temps sont indéterminés, donc un seul et même réel khaosique infini.
La relation khaosique existe-t-elle dans un tel état d’indétermination? Certains physiciens opinent que nos électrons sont indéterminés dans l’espace-temps, pouvant donc se retrouver dans nos neurones d’une part; également à des milliards d’années-lumière dans le maxicosmos. Je vais en envoyer quelques-uns vérifier si un tel état préexiste toujours quelque part dans l’Univers [Des crétins vont prendre ceci au sérieux, c’est certain!]
1.92.4 Notion métaphysique de puissance
Le substantif «puissance» est formée à partir de certaines formes irrégulières du verbe «pouvoir». Ainsi, au subjonctif présent trouve-t-on la forme «que je puisse». Au subjonctif imparfait: «que je pusse»... Comme dans la phrase «Il eut eu fallu que je pusse décrocher un doctorat el métaphysique pour que je puisse aujourd’hui me voir reconnaître universellement»... Voilà une forme très littéraire que plus personne n’utilise, même en littérature!
À l’indicatif présent, deux formes sont offertes: «je peux», forme la plus usuelle; «je puis» forme progressivement abandonnée.
Bref, nous retenons le radical«puis» auquel nous joignons le suffixe «ance» induisant les idées d’action ou d’objet, lieu et résultat de l’action; les idées de qualités, de propriétés.
Dans la langue populaire, on attribue au vocable l’idée de «pouvoir faire», idée à laquelle on attribue des caractéristiques de grandes capacités. En métaphysique de tradition péripatéticienne [Aristote et autres], il en va autrement.
La puissance se définit comme pouvoir être en soi, non définie par une structure particulière, donc en soi infinie. Ainsi l’humanité est une manière d’être en puissance. Quand cette puissance s’incarne dans un être particulier, elle devient un humain, un être défini donc fini. Il en est de même des roses, des chars d’assaut, des bactéries, des nébuleuses...
La puissance est à la fois potentiels et forces.
1.92.5 Contingencité
Le Khaos, relation et puissance, s’établit comme assises de la Contingencité de l’Être universel. Sont ainsi khaosiques tous objets réels possibles, qu’il s’agisse d’objets potentiellement tangibles comme des arbres ou des atomes, d’objets intangibles comme les idées ou l’affection des toutous et des minous pour leurs propriétaires.
1.93 L’ontarchie
1.93.1 Formation du vocable
Terme composé de deux vocables grecs:
-) «Ta onta» signifiant littéralement «les Étants». Traduction libre: les réalités réellement réelles!
-) «Archè» signifiant au propre «qui est en avant». Par extension: principe, origine. S’en suivent de nombreuses acceptions figurées, comme dans monarchie, patriarche etc.
1.93.2 Notion d’ontarchie et dérivés
Par ontarchie, nous entendons ici l’Être universel en tant que principe générateur de toutes existences actuées.
Par ontarchique, nous entendons: qui se rapporte à l’ontarchie.
L’ontarchie est un principe causal s’exprimant sous quatre formes:
-) Causes formelles (typonomie)
-) Causes efficientes (kinètonomie)
-) Causes finales (téléonomie)
-) Causes chréosiques (déontonomie)
En tant que cause formelle, l’ontarchie détermine la manière d’être des objets réels en conformité avec des archétypes inscrits dans la nature.
En tant que cause dynamique, l’ontarchie agit, mû par ses propres capacités.
En tant que cause finale, l’ontarchie détermine l’existence des êtres dans l’optique d’une finalité inexorable: la pérennité pour l’Être universel; la durée pour les choses et phénomènes; la survie pour les êtres vivants.
En tant que causes chréosiques, détermine les nécessités indispensables à l’atteinte des objectifs téléonomiques des êtres et les dote des capacités d’adaptation requises par leur nature [le grec «khréos» signifie nécessité].
La pièce archéologique que voici:
Elle nous provient d’une civilisation que les Mésopotamiens appelaient «Meluhha»; les archéologues contemporains «Indusienne» ou «Harrapéenne». Cette civilisation a existé pendant sept siècles pour disparaître vers 1900 avant notre ère, sur un territoire correspondant plus ou moins au Pakistan actuel.
Dans ce journel, nous considérons cette civilisation très évoluée quant aux connaissances techniques, astronomiques et autres comme la Mère de toutes les métaphysiques.
La pièce archéologique ci-haut, retrouvée dans une cité indusienne, illustre deux propriétés de l’Univers:
-) L’image de droite: l’infinité de l’Univers;
-) L’image de gauche: la perpétuité du mouvement universel.
Ces deux propriétés métaphysiques s’avèrent toujours d’actualité.
L’ontarchie se définit comme un principe autogéré actionné par nul agent externe. Ainsi fonctionne la nature dans toutes ses dimensions: macrocosmos, microcosmos et mezzocosmos à notre échelle.
La création de l’univers par un agent externe, quel qu’il soit, n’est que croyance chimérique, produit de l’imaginaire des humains, pour expliquer l’inexplicable: l’origine du monde. L’existence de l’Univers redevable à un agent extérieur est insoutenable en Physique et contraire à l’Ordre qui régit cet Univers.
On arguera que la science n’explique pas tout. Disons que depuis la naissance du monothéisme il y a plus de deux millénaires, la science a résolu passablement de mystères. Que dans deux autres millénaires, peu de mystères ne seront résolus.
Par contre, les superstitions exaltent de nombreuses représentations fantasmatiques, persistances des fabulations infantiles, mais n’expliquent rien de fondé et de vérifiable.
Il est peut-être temps d’arriver au 21ème siècle!
La puissance khaosique est meublée d’archétypes aux possibilités indéfinies d’une part, à la typologie spécifique d’autre part. Les possibles non actués constituent des substrats dont les possibilités de devenir sont infinies. Des segments de ces possibilités infinies vont se voir actués par le principe générateur universel inhérent à l’Être de l’Univers, que nous appelons ici ontarchie.
C’est donc quand une portion de cette infinité est actuée par ce processeur naturel immanent qu’est l’ontarchie que la dite portion acquiert une finitude. On appelle «actuation» l’acte par lequel une portion de puissance s’incarne dans une individualité. Telle actuation est le fait de l’attribution d’une structure à cette portion de puissance ou de pouvoir être.
Puissances infinies, individualités actuées finies. Voilà qui explique la variété et la richesse des êtres de nature: une puissance incarnée dans une individualité l’est de manière unique et originale.
Ainsi, parce que participant de l’humanité, un humain est similaire aux humains; parce qu’entité individualisée, il est différent des autres humains. Deux galaxies sont deux galaxies mais diffèrent entre elles. La similarité induit l’idée qu’il existe du pareil (identique) et du pas pareil (différent).
L’acte qui conduit à la création d’une entité individualisée est d’ordre binaire; cette entité s’avère cependant d’ordre contingentiel.
Sont impliquées les causalités formelles et efficientes.
1.93.7 L’ontarchie comme régime régulateur de l’Univers
La relation khaosique est indéterminée, de ce fait infinie. Elle est activée quand elle devient rapport et interactions entre des objets créés, choses ou phénomènes.
Des régimes ontarchiques lui confèrent alors des déterminations particulières et une finitude, dépendant des objets visés par ses interrelations. Les régimes qui régissent [des régimes par définition régissent...] les interrelations au sein des divers cosmos pourraient se voir qualifier d’instincts de l’univers. Au sein de la biosphère, ce n’est pas là métaphore mais réalité observable.
Par cosmos, entendons «une portion d’univers». Rappelons qu’existent des maxicosmos, des microcosmos et le mezzocosmos à notre échelle dimensionnelle.
Également sont des cosmos une galaxie, un système solaire, la biosphère, un pays, une famille... Toute parcelle d’Univers constitue un cosmos.
Le problème de nombreux physiciens consiste à confondre Univers et cosmos. Ce qui a émergé du Big-bang est un maxicosmos, que certains physiciens considèrent comme la regénérescence d’un cosmos antérieur qui s’est contracté pour se régénérer, puis se recommencer. Le problème: le phénomène n’a pas de témoins, exception faite toutefois de la présence de zones froides perceptibles par les télescopes que certains attribuent à un cosmos antérieur.
Certains physiciens qualifient même ce Big-bang d’utopie scientifique! On peut consulter les argumentaires de l’article cité en 0.32.4. L’article résume bien les incertitudes scientifiques. Son objectif: la science doit s’accompagner de la foi parce que la science n’est pas nécessairement certitude absolue!
Questions: foi en quoi? Foi en quelles fois?
Les incertitudes scientifiques contemporaines ne justifient en rien la crédulité en des mythes antiques! Répétons-le car c’est la redondance qui transforme un bruit en information: il est temps d’arriver au 21ème siècle!
1.93.8 Le premier moteur
Ce que nous appelons ici ontarchie, Aristote et les péripatéticiens la dénommait “Premier moteur”. Ce terme cependant ne faisait absolument pas allusion à quelque divin que ce soit.
Les panthéistes cependant, récusant l’idée d’un divin créateur distinct de sa création, ont conféré à ce premier moteur une connotation divine. Ce divin toutefois, aussi divin soit-il, n’interviendrait pas dans le vécu des humains. Ce divin, aussi divin soit-il, ne serait d’aucune manière un être créé à l’image et à la ressemblance des humains. Désolé pour les tenants du monothéisme... [Pas tant que cela...!]
1.94 Intellection
L’ontarchie, en tant qu’acte générateur, fait surgir les objets réels dont nos systèmes percepteurs captent les configurations essentielles à notre survie.
L’intellection humaine comporte la perception des objets réels, choses et phénomènes, par les sensoirs. Ceux-ci traduisent les configurations perçues en signes régis par des codes inhérents aux systèmes perceptifs et transmis au cerveau reptilien et à l’encéphale.
Le cerveau reptilien régit les réactions émotives; l’encéphale reconstruit l’objet réel perçu pour former l’objet mental.
Nous avons traité cette question épistémologique plus haut en 1.54 d’abord; en 1.82 ensuite. Il n’est pas opportun d’élaborer d’avantage.
1.95 L’objet mental
1.95.1 Ce qu’est l’objet mental
L’objet mental n’est pas une chose comme une galaxie, un atome, un visage... On doit faire l’effort mental d’éviter la chosification de l’objet mental, également du sujet mental. Les idées, les notions ne sont pas des choses.
L’objet mental n’est pas un phénomène comme une tempête de neige ou de sable, la pluie sous un ciel couvert, un astre englouti par un trou noir. Il faut éviter de phénoménologiser l’objet mental, également le sujet mental
[Phénoménologiser n’est pas dans les dictionnaires mais grammaticalement bien construit, on peut l’ajouter à son vocabulaire].
1.95.2 L’objet mental, produit d’un système
L’objet mental, tout comme le sujet mental, n’est que le produit d’un système d’intellection régi par l’information.
L’objet mental est le produit d’un système intellectif qui n’a d’existence que comme image mentale.
On peut comparer à l’image reproduite sur support papier. Une photo, c’est un ensemble de configurations coloriées ou en noir et blanc qui va reproduire l’objet réel. Une image sur ordi ou téléphone portable, ce n’est rien d’autre qu’un ensemble de pixels. L’objet reproduit n’existe pas comme tel.
Une représentation, une image n’existe que sur un support. On détruit le support, on détruit la représentation.
L’objet mental comme représentation mémorisée existe sur un support moléculaire sis dans le protoplasme des neurones. Dans un phénomène comme l’Alzheimer, quand les cellules sont détruites, la mémoire des représentations mentales s’envole également.
L’objet mental est la représentation de l’objet réel perçu – chose ou phénomène — inscrite et conservée dans des molécules neuroniques. Ces molécules se cacheraient dans L’A.D.N. neuronal. Que la mémoire soit générée par l’interaction électrique des neurones a vécu! Place à l’épigénétique.
Voilà qui renforce la conviction que l’objet mental reconstruit par ce processeur qu’est l’intellect humain n’est ni une chose, ni un phénomène. Qu’un ensemble de signes codés inscrits dans le protoplasme des neurones.
C’est une caractéristique essentielle de la contingence de s’avérer une ÉTANCE, et non un ÉTANT. Un objet mental est une ÉTANCE, non pas un ÉTANT. L’objet mental appartient donc à l’Ordre de la contingence.
1.96 Notre concept de forme
1.96.1 Définition
La forme est une notion se référant au principe générateur universel de tout ce qui est: manière d’être et manière d’agir des êtres de nature.
La forme est liée à l’objet mental, et non à l’objet réel. Référer au tableau édité en 1.91.
La forme est une représentation mentale binaire qui simule l’être et l’agir du principe universel ontarchique. Produit de l’intellect humain, elle remplit une double fonction.
1.96.2 Conformation des objets
La forme représente en le simulant le principe générateur qui attribue aux êtres leurs natures propres; elle est alors simulation de la conformation des objets perçus – choses et phénomènes ainsi que de l’information qui les régissent.
Dans un même acte, elle conforme les données perçues pour assurer une représentation des objets simulés en adéquation avec les dits objets. Ainsi, les chiffres un, deux ou quatre n’existent pas dans le Réel. Une conformation subjective du Réel nous amène à concevoir UNE fenêtre et UNE fenêtre = DEUX fenêtres.
Sur le mur, on se représente QUATRE fenêtres. Sauf que une, deux, quatre fenêtres n’existent pas dans le Réel — répétons-le! Ces chiffres sont la simulation de la conformation d’une manière d’être d’un réel: quatre fenêtres sur un mur. On se cause ici d’un sujet mental en adéquation avec l’objet mental, celui-ci en adéquation avec l’objet réel.
Rappelons-nous les processus d’intellection: [symbole des flèches: ⇨ = perception /intellection; ➔ = adéquation au réel.]
Objet réel ⇨ perception ⇨ intellection ⇨ objet mental ⇨ sujet mental ➔ objet mental ➔ objet réel.
A) La forme représente mentalement le principe ontarchique régissant les manières d’agir des systèmes opérationnels; elle est alors représentation de l’information régissant les systèmes et processus naturels. Ce type de simulation doit tenir compte des nomies dont nous avons causé plus haut [Revoir si besoin 1.4].
B) La forme également représente mentalement la conformation par le principe ontarchique des êtres meublant l’Univers — choses ou phénomènes.
Conformation et information sont générées par les données programmées par les codes inhérents à la perception humaine et décodées par ce processeur qu’est l’intellect humain. C’est pourquoi on se cause ici d’intellection humaine.
L’intellect humain fonctionne de manière autonome, tout comme l’instinct. On peut parler de souveraineté - association. Le cerveau est une fédération de processeurs. La conscience humaine “prend conscience” des productions de ces processeurs quand surgissent des alertes. Autrement, tout se passe aux niveaux inconscient et subconscient.
1.97 Notions de texte, texture, tessiture, contexte...
1.97.1 Texte, texture, tessiture, contexte
Quel lien doit-on établir entre texte, texture, tessiture et contexte?
Pour ce faire, il importe de définir le vocabulaire utilisé. Brève présentation des acceptions de ces vocables, afin d’éviter au lecteur des recherches ailleurs.
Auparavant, le tableau que voici, commenté dans cette section:
1.97.2 Texte: en littérature
Dans le langage courant, un texte désigne la totalité des mots d’un écrit, d’une oeuvre. Il s’agit cependant là de l’application particulière de l’idée de «texte», notion qui s’applique à moult entités autres.
La définition ci-devant fait émerger l’idée d’un produit: le produit d’une activité qui consiste à assembler des mots pour produire des idées, des concepts, des images etc. Le tout crée le texte.
L’origine latine du vocable inclut davantage que l’application à un texte écrit. Voyons voir!
1.97.3 Origines et significations latines du vocable
Le mot vient notamment du latin «textum» signifiant: 1) tissus, étoffe; 2) contexture, assemblage.
Le mot «textŭs», substantivation du participe passé de «texo», a la même signification: enlacement, contexture.
Le verbe signifie au propre “tisser”. D’où les emplois figurés: entrelacer, construire en entrelaçant, tresser...
Un texte induit l’idée d’une construction par entrelacement, association, assimilation de composantes.
Un texte s’avère par conséquent un produit doté d’une structure acquise par la construction d’une telle entité.
1.97.4 Liens logiques
Ce produit l’est soit d’une action stéréospécifique ou stéréosélective. Un texte appartient donc à l’une de ces deux catégories [cf. 0.4 Terminologie; Catégorie: le Grand Notionnaire].
Logiquement, un texte ne peut être membre d’une catégorie spécifique et membre d’une catégorie concurrente, parallèle, voire de nature complètement différente.
Laissons-nous emporter par la fiction un instant. J’emprunte mon exemple à Jacques Monod, un biologiste du siècle passé qui a commis deux essais métaphysiques. Je traite cependant cet exemple différemment.
Des étranges d’ailleurs dans l’Univers survolent, disons, un désert de Libye. Ils y perçoivent un cheval galopant au côté d’un char d’assaut. Ignorant tout de notre planète, ces étranges n’y voient que deux entités trottant sur un sol sablonneux. Ils en concluent qu’il s’agit d’une même catégorie d’Étants mouvants, mais comportant deux formes distinctes [sous-catégories]: une forme ovale et une forme rectangulaire.
Fiction donc, qui ne s’appliquerait pas au réel contemporain? Vraiment?
Qualifier les téléphones cellulaires d’intelligents confine à la même turpitude illogique! L’intelligence est l’activité d’un bio-ordinateur cérébral appartenant à la biosphère alors qu’un téléphone cellulaire électronique n’est qu’un artefact robotisé et informatisé.
L’atome est un exemple de structures universelles communes à toutes les entités... RELATIVEMENT. Il faut tenir compte du type d’entités et des éléments les composant. Ces structures s’avèrent donc différemment similaires ou similairement différentes.
L’atome est un tissu, c’est à dire une entité dont la trame se compose d’un noyau et d’électrons qui lui tournent autour. Le texte atomique est le produit de l’entrelacement de tout ce beau monde.
Le noyau est à son tour le produit de l’entrelacement de composantes: les protons et les neutrons.
Protons et neutrons sont eux-mêmes constitués de particules élémentaires fortement entrelacées... vu à notre échelle. Cet entrelacement est plein de vide... Mais ce vide serait plein de matière/énergie que l’on appelle champ. L’atome est un exemple de ce qu’est un texte.
Du radical «text» auquel se joint le suffixe «ure» induisant les idées de qualité [comme dans dorure], d’ensemble [armure], de résultats d’une action ou d’un incident [cassure], d’une contrainte [dictature], d’une activité [gravure].
Le vocable exprime la manière dont un texte est structuré, structure qui en détermine à la fois la typonomie et la téléonomie [Revoir la notion d’ordre en 1.4 plus haut].
La texture constitue le volet binaire dominant d’un texte.
1.97.7 Tessiture
Le vocable nous vient du latin «tessere», signifiant également tisser.
La tessiture exprime les idées d’adaptation, d’expansion, de complexion, de manière de se comporter donc d’agir tels l’harmonique, la fréquence, la densité...
Les Italiens ont introduit le mot dans le champ musical pour désigner l’étendue d’un organe vocal. Les anglophones utilisent le mot registre.
La tessiture est une infrastructure qui, en physique, détermine la kinètonomie [ex. Rythme, cadence] et la déontonomie [spectre, adaptation, régulation etc].
La tessiture constitue le volet contingentiel complémentaire d’un texte.
En tant que concept
Le vocable «texte» constitue un icone binaire dont la texture détient le volet primaire binaire et la tessiture, le volet complémentaire contingentiel.
En tant que notion
Entité de type binaire, produit de l’incorporation, l’association, l’entrelacement, l’amalgame, l’entrecroisement de composantes formant un tout et constituant une catégorie spécifique.
Entité composante d’un objet de catégorie supérieure, par intégration, association, réseautage etc.
Exemples.
Un texte littéraire est composé de lettres, de mots, d’idées, de règles grammaticales sur support physique ou électronique. Tout texte constitue une catégorie.
Un texte est partie intégrante d’un billet, d’une chronique, d’un article, l’un bouquin etc. Tout texte est une sous-catégorie d’un ensemble.
Un être humain est composé d’atomes, molécules, squelette, muscles, graisses, organes etc. Tout humain est un texte constituant une catégorie.
Un être humain est partie intégrante [pas toujours intégrée] d’une famille, d’une tribu ou de relations étendues, d’une société, d’une nation. Tout humain est un texte constituant une sous-catégorie d’un ensemble.
En aucun cas un texte s’apparente-t-il à une monade flottant dans un vide sidéral.
1.98 Notions de contexte et de contingencité...
1.98.0 Contexte, hasard et nécessité
Le contexte se positionne comme l’environnement du texte et en fait ressortir le sens.
Contrairement à la signification qui est de nature statique, le sens est dynamique, se véhiculant en périphérie et au travers du texte.
Le tableau suivant que nous allons commenter.
Les ondes couleur bleutée: contexte externe;
Les ondes couleur orangée: contexte interne.
Le tableau se veut une simulation de l’impact des contextes sur les textes.
Tout contexte a un double volet: intérieur et extérieur.
Également, toute modification contextuelle peut amener la modification d’un texte.
Contextes internes et contextes externes sont intimement liés.
Un texte littéraire est composé d’éléments littéraires et membre d’une entité littéraire.
Un texte humain est composé d’éléments humains, lui-même composant d’entités humaines.
Tous contextes, de quelques types que ce soit, sont régis par les mêmes nomies, RELATIVEMENT!
-) Relativement parce que les rapports et interactions dépendent du type de textes affectés et de morphogenèses différentes [typonomie].
-) Relativement parce que les textes émergent et se développent selon leurs systèmes d’animation et organisations propres [kinètonomie].
-) Relativement parce que chaque texte est régi par ses propres normes d’adaptation et de conditions de survie [déontonomie].
-) Ces normes d’adaptation ont pour objectifs la pérennité (Univers), la durée (entités naturelles), la survie (la biosphère) [téléonomie]. La mort d’un vivant ou celle d’une étoile ont pour objectif la survie de la race ou la durée du cosmos.
Tout texte est régi par des lois internes inexorables. Sinon, il y a perte de signifiance dans les cas de textes littéraires, perte d’existence [destruction] d’objets naturels.
Seul un contexte externe peut modifier l’exécution d’une loi naturelle, modifier un état, un fonctionnement quelconque.
Ainsi, un avion peut s’arracher à la gravité grâce à des ailes, une motorisation adéquate, une série d’éléments technologiques. Il s’agit là d’organes contextuels particuliers. Qu’une aile s’arrache et l’avion tombe. Parce que la loi est inexorable.
Autre exemple, sordide celui-là. Les malfrats du pseudo-califat d’Asie occidentale, d’Afrique et d’ailleurs ont fait la démonstration à Mossoul que chaque fois que l’on projette un mécréant du haut d’un édifice, il va s’écraser au sol. Jamais n’est-il parti pour la lune. Le poids d’un objet sur terre fait en sorte qu’il est inexorablement soumis à la gravité terrestre.
Changeons de domaine. Si on étudie à l’aide de méthodes scientifiques – analyses chimiques, rayons X d’organes – l’impact de l’aspirine sur l’estomac, on peut vérifier objectivement cet impact. Le médicament est un élément extérieur à l’organe qui peut modifier la texture de l’organe. Sinon, l’estomac demeure régi par ses lois régulatrices internes.
Tout est affaires de contextes. Les épifacteurs contextuels sont des agents pouvant modifier des facteurs à divers niveaux. Nous abordons cette question plus bas.
1.98.4 Contextes intérieurs.
Au regard du contexte intérieur, une démarche “scientifique” est théoriquement sensée... Vraiment?
Pas vraiment quand il s’agit d’études empiriques, lesquelles se présentent faussement comme scientifiques.
Lors de telles études, les contextes internes sont variables: objet de l’étude; type de professionnalisme et d’idéologies des chercheur(e)s; typologie des cobayes; type d’environnement physique, social, culturel etc. Que l’on modifie un seul élément de ces contextes internes et les résultats seront d’autant modifiés. Les résultats ne peuvent constituer autre chose que des constats. Constats aléatoires, contingentiels, qui seront tôt ou tard contredits par d’autres constats aléatoires, contingentiels.
Exemples de contextes aléatoires.
L’aspirine, bon ou pas bon pour la santé? Ça dépend de l’objet de la recherche, des sujets analysés [comparer des groupes qui prennent le médicament à des groupes qui n’en prennent pas], qui paie pour la recherche... Les variantes sont presque infinies.
Le Roundup de Monsanto, cancérigène ou pas cancérigène?
Pour l’agence Santé Canada, pas de problèmes démontrés. Pour de nombreux groupes d’activistes ou même médicaux, la substance serait cancérigène. La différence d’opinion s’explique par le fait que les chercheur(e)s “scientifiques” opinant que la chose est sans conséquences morbides sont lié(e)s à Monsanto soi-même!
Domaine de la psychiatrie, parangon de la pseudo-science! Tel individu ayant commis un crime était-il sain d’esprit au moment de commettre son acte? Selon que l’on voudra démontrer que oui ou non, sera-t-il possible de dénicher le/la psychiatre qui va démontrer de manière “scientifique” ce dont on a envie d’entendre. Lors de procès criminels, les versions opposées de psychiatres sont denrées courantes.
Certains contextes intérieurs peuvent être fauteurs de non-sens.
Dans le domaine littéraire, verbal, social ou autre, un texte exprimé peut s’avérer significatif mais n’avoir aucun sens. L’exemple que voici:
Ce texte peut bien, à la limite, signifier quelque chose. Mais sa contexture fait en sorte qu’il n’a pas de sens!
On ne doutera pas que le racisme préservatif, lequel s’avère inévitablement réjectif de ce qui n’est pas soi, soit très significatif sur le plan identitaire. Parce qu’à terme un tel racisme s’avère suicidaire ethniquement et socialement, il s’avère de ce fait un non-sens. Tel non-sens se répercute sur la qualité de vie individuelle et sociale des humains résidant dans des enclos ethniques que l’on peut bien qualifier de «zhoomains». La survie de telles tendances identitaires exclusives se voit pourtant défendue par une certaine bienpensance erratique, quand ce n’est par des lois et des jurisprudences non moins erratiques.
Les contextes internes comme externes sont d’essences contingentielles. Pourquoi?
Le tableau que voici:
La contingencité peut se définir comme une nécessité de nature variable, qui peut cependant se voir affectée par des circonstances aléatoires, hasardiques.
Le caractère nécessaire déterminant un objet réel est constitué d’un ensemble de facteurs générés par des données spécifiques organisées par des systèmes tout aussi spécifiques. C’est le volet dominant de l’icone “contingencité”.
Ces facteurs peuvent cependant se voir affectés par des épifacteurs aléatoires: événements fortuits, conditions, circonstances, influences, conjonctures etc. Ces épifacteurs peuvent modifier partiellement, grandement, totalement, minimalement les facteurs affectés. Il ne s’agit pas ici de modifications de l’ordre du plus ou moins [ce qui est de l’ordre de la contingencité] mais bien d’une échelle d’impacts qui peut se mesurer [ce qui est de l’ordre de la binarité].
Les contextes externes doivent être considérés comme des épifacteurs. Ces épifacteurs constituant des contextes externes feront en sorte que les facteurs vont s’exprimer, ne pas s’exprimer ou s’exprimer à des degrés divers.
Les facteurs sont de nature variable que les épifacteurs peuvent reparamétrer.
Ainsi l’ouragan Dorian devait traverser la Floride. L’apparition d’un courant-jet, fruit du hasard, a finalement détourné l’ouragan de sa trajectoire initiale. Le courant-jet interagit comme un épifacteur hasardique.
La génétique avancée considère que la transgenrité est causée par l’action d’épifacteurs de nature chimique affectant le développement surtout du chromosome 49, de telle sorte qu’un individu peut s’avérer d’un sexe donné mais se voir doter d’organes génitaux de sexe opposé.
Un facteur est le produit d’un système. Tout produit se présente comme un ensemble de données ou signes codés régis par l’information. Or l’information peut se voir “conditionnée” par des valeurs provenant de l’environnement externe, valeurs constituant des “équations” [interactions entre valeurs connues et/ou inconnues] susceptibles de modifier ou transformer physiquement, chimiquement ou autrement un produit donné.
Les rétroactions sont des épifacteurs pouvant modifier un acte [les actes sont des produits].
Ces épifacteurs sont de type binaire.
Parce que tout texte émerge d’un contexte ou peut se voir modifier par l’icelui, logiquement donc, le contexte prime sur le texte.
Par contre, parce que doté de macrostructures et d’infrastructures, le texte est d’un niveau d’organisation supérieur au contexte. Nous revenons sur ce point plus bas sur cette page.
Parce que doté de macrostructures et d’infrastructures perceptibles par nos sensoirs, le texte est connaissable et donc, signifiant.
Dans la nature, le contexte n’est connaissable que via le texte, l’icelui en constituant l’instrument de connaissance.
Dans les domaines de la recherche scientifique, empirique ou simplement de la connaissance humaine, le contexte est l’instrument du texte.
Textes et contextes ne sont d’aucunes manières dans le Réel – maxicosmos, nanocosmos, mezzocosmos – des entités existantes. Ne s’agit-il que de catégories mentales qui se veulent explicatives du réel, en adéquation avec le Réel.
Le tableau que voici;
Le vocable «Contexte» vient du latin «contextus» et fait référence à l’idée d’assemblage. Nous attribuons ici au mot l’acception suivante: organisation des environnements internes et externes.
Le contexte n’est donc pas une entité mais une organisation.
La contexture ne fait donc pas référence à une structure puisqu’il ne s’agit pas d’entités. Le vocable fait référence à une infrastructure organisationnelle, soit l’information régissant les systèmes.
La contexion est un néologisme de notre cru. Le vocable francise le verbe latin «contexere». Nous lui faisons ici signifier le fait d’insérer un texte dans un contexte. Cette notion ferait le bonheur de Kant mais le philosophe ne peut avoir tout faux!
Tout contexte s’avérant de type contingentiel, la contingencité emprunte donc les mêmes valeurs que le contexte, à savoir: primarité «ontologique» de la contingencité sur la binarité.
Parce que toute entité binaire émerge d’un champ khaosique contingentiel, logiquement donc, le contingentiel prime sur le binaire.
Par contre, parce que doté de mégastructures et d’infrastructures, le binaire est d’un niveau d’organisation supérieur au contingentiel.
Parce que doté de structures et infrastructures perceptibles par nos sensoirs, le binaire est connaissable et donc, signifiant.
Dans la nature, le contingentiel n’est connaissable que via le binaire, l’icelui en constituant l’instrument de connaissance.
Dans les domaines de la recherche scientifique, empirique ou simplement de la connaissance humaine, le contingentiel est l’instrument du binaire.
Binarité et contingencité ne sont d’aucunes manières telles quelles dans le Réel – maxicosmos, nanocosmos, mezzocosmos confondus – des entités existantes. On ne le répétera jamais assez: ne s’agit-il que de catégories mentales qui se veulent explicatives du Réel, en adéquation avec le Réel.
Exemple d’adéquation au Réel: la découverte du boson dit scalaire.
Jusqu’au quatre juillet 2012, le phénomène n’était qu’hypothèse explicative de phénomènes inexpliqués.
En ce jour, le collisionneur qui fait des kilomètres sous terre a perçu un tel boson grâce à une collision que nous ne décrirons pas ici. L’espace d’une nanoseconde, une structure fut conférée au boson qui a occasionné sa perception. L’exploitation d’un environnement contingentiel a permis la saisie d’une structure binaire. Le contingentiel fut alors l’instrument du binaire. Ce parce que nos sensoirs ne perçoivent que des objets – choses et phénomènes – de type binaire.
Il en est ainsi dans tous les départements de la connaissance humaine parce que c’est ainsi que fonctionnent les bio-ordinateurs cérébraux des humains.
1.98.9 Définition
En tant que concept
Le contexte est un icone de type contingentiel simulant les environnement internes et externes d’une entité textuelle.
La contexion désigne le fait que tout texte s’insère invariablement dans un contexte dont il émerge. Elle est de type contingentiel et constitue le volet primaire du contexte.
La contexture désigne le modèle structurel d’un contexte. Elle est de type binaire et constitue le volet complémentaire du contexte.
Par contexte, nous désignons l’environnement d’où émerge un texte. Cet environnement est schizogénique: il habite l’intérieur du texte d’une part; fait office de champ existentiel externe sinon nul texte n’existerait d’autre part.
Le contexte est le produit d’un système géré par l’information et la condition sine qua non de l’existence de tout texte.
~ II ~
Assises ontologiques
de la contingencité
2.0 L’ontophysique
Du grec «ontos» traduisible par «l’Être»»; du grec «Fusis» traduisible par «Physique» que nous avons défini comme l’Ordre régissant l’Univers.
Définition: l’Ordre qui régit l’Être de toutes choses et phénomènes.
De savant(e)s doctorisé(e)s utilisent le vocable traditionnel en philosophie «Ontologie» pour désigner la métaphysique des Grecs anciens. L’ontologie serait une branche de la philosophie. Or à l’époque de Platon, Aristote et autres grands penseurs, le mot n’existait pas.
Aristote n’a également jamais utilisé le mot «métaphysique», l’icelui également fut créé bien après sa mort.
Il existe quand même une différence entre les définitions que l’on donne depuis des millénaires aux vocables «ontologie» et «métaphysique».
L’ontologie se présente davantage comme une doctrine portant sur la “science de l’être”. De nombreux penseurs ont développé une multitude de doctrines portant sur l’Être universel, plusieurs débouchant sur des théologies. C’est là une approche que nous n’adaptons pas en ce journel.
La métaphysique, celle basée sur les catégories d’Aristote, se présente d’avantage comme une grille d’analyse permettant d’étudier l’Être universel et ses composantes. C’est l’interprétation que nous adoptons ici.
Ce modèle, c’est de la métaphysique authentique que nous dénommons en ce journel «cybermétaphysique». Sauf que cette approche ne s’effectue pas sous l’angle ontologique traditionnel mais néanmoins étudie l’être des choses et phénomènes sous l’angle des structures, systèmes, échanges, communications, rétroactions, bruits, information etc. À nos yeux en ce journel, c’est de la métaphysique sans le nom.
Le grec utilise deux formes du verbe être: «Ôn-ontos» traduisible par «Étant»; «Ousia» traduisible par «Étance».
Ce sont les traductions que nous utilisons en ce journel.
La métaphysique traditionnelle utilise plutôt les traductions s’originant du latin: substance et essence.
Voilà qui va permettre de suivre la présentation qui suit.
2.1 La notion grecque de «l’étance» et ses dérivés
2.11 L’ousia grecque
Les philosophes depuis des disciples d’Aristote et Platon en passant par les métaphysiciens médiévaux et ce, jusqu’à nos jours ont traduit le vocable grec “Ousia” les uns par «substance», les autres par «essence». Nous croyons pertinent ici de disqualifier le mot «essence» parce que trop charrié par l’histoire. Il en va autrement du mot «substance» dont nous préciserons les acceptions. Nous ne considérons cependant pas ce vocable comme une traduction du grec «Ousia».
Le vocable grec est formé du participe présent du verbe être “εἰμί» [être]. «Ousa» est le participe présent féminin de ce verbe être. «Ousia» est un substantif que nous traduisons ici par «Étance».
2.11.2 L’Ousia comme catégorie aristotélicienne.
Aristote fut un génie doté d’une intuition exceptionnelle de la nature fondamentale de l’Univers. Voici pourquoi.
En élaborant sa grille d’analyse dans ce que nous pouvons appeler le département des catégories, il a placé l’ousia en tête des icelles: «πρὤται οὐσίαι» – premières étances. Cette classification mérite de survivre.
«Prôtai» induit l’idée de primarité temporelle, ce qui est en tout début. Si cette catégorie est au premier rang des catégories, c’est qu’elle renvoie à l’état premier de l’Être universel ou Univers. Or pour les Grecs, cet état premier était khaosique.
2.11.3 Notion de substance comme équivalent le grec «ousia»
Substance: le vocable s’origine du latin, mot composé de «sub»: sous, dessous, par dessous; «stare»: se tenir.
Le verbe «substare» est apparu vers le 1er siècle de notre ère, signifiant «être dessous».
Le substantif «substantia» existait bien auparavant, que le dictionnaire “Gaffiot” traduit par être, essence, substance, existence, réalité d’une chose. Ces traductions sont empruntées aux métaphysiciens et théologiens du Moyen-Âge, suivis en cela de philosophes plus récents.
Ces penseurs des siècles passés ont utilisé le vocable pour traduire le grec «ousia». Assez malencontreusement! La substance induit l’idée de ce qui se tient dessous un Réel quelconque. L’ousia induit l’idée de manière d’être, donc d’agir, de se comporter, avec idée de profil.
Par contre, l’intuition que sous tout réel existait un substrat imperceptible, indéfinissable tient toujours la route! De fait, avec le développement de la physique subatomique et de la physique quantique, la notion de substance prend de la valeur.
Prend de la valeur? Pas pour tout le monde!
2.11.4 Discussion portant sur le “substantialisme”.
Patrick Juignet, lien à son article en 0.32.2, présente trois définitions dont la deuxième rejoint notre point de vue:
... le substantialisme métaphysique suppose une entité permanente, la substance, comme support de toute chose qui existe par elle-même et ne dépend de rien. C’est une hypothèse métaphysique sur le fondement du monde.
Il s’agit là d’une interprétation parmi d’autres. Sauf que nous n’adhérons pas à ces “autres” interprétations et conceptions, ni davantage à la conclusion suivante de l’auteur:
La notion de substance étant source de difficultés et de confusions, il paraît préférable de l’éviter pour qualifier ce qui existe de manière permanente. Décréter le réel substantiel est inutile et source de confusion, car il faut ensuite savoir ce qu'est la substance et combien il y en a, ce qui conduit à des spéculations métaphysiques.-) Décréter que le réel substantiel est inutile n’est plus justement inutile: la Physique postule de nos jours avec grand sérieux l’existence réelle d’une telle matière/énergie substantive [non perceptible].
-) La substance est de nos jours source de confusion, mais de la part de physiciens.
-) Il faut savoir ce qu’est la substance... Les physiciens la qualifient de matière sombre ou noire et ne savent trop ce qu’elle est. On cause de particules... Existent-t-elles vraiment?
-) Combien y a-t-il de substances? Fausse question. La substance désigne un ensemble global, pas une série d’entités diverses.
-) Les spéculations métaphysiques sont légitimes quand fondées sur la Science. Sont illégitimes si fondées sur les ergotages des philosophes.
De fait, cette analyse est fondée sur une notion erronée, à savoir que la substance – ou les substances – seraient des entités. Or la substance n’est pas une entité mais une étance, donc un réel contingentiel.
2.2 Khaos, matière noire, substance...
2.21 Existence réelle du Khaos
Nous avons discuté de la notion de Khaos au chapitre neuf du Titre I, section deux [cf 1.92]. Nous y avons insisté sur le fait qu’il existe une distinction entre le Khaos et le Khéos, distinction qu’ont ignorée le latin ainsi que les langues inspirées du latin.
Pour les métaphysicien(ne)s d’inspiration péripatéticienne [Aristote et autres], le Khaos loge les substrats de la matière, que l’on désigne par le terme substance.
2.21.1 Définition partielle du Khaos
Selon notre optique, le Khaos se définit comme puissance et relation.
La puissance est potentielle et forces, sous-jacente à tout ce qui est actué, donc binarisé, donc perceptible. Ce substrat n’est cependant pas perceptible parce que justement, pas actué.
Il s’agit là d’un cosmos contingentiel à l’état... qualifions cet état à ce stade-ci de brut.
2.21.2 Khaos et matière noire
Certain(ne)s physicien(ne)s opinent que les états subatomiques sont de nature khéosiques: le désordre absolu!
Certain(ne)s physicien(ne)s opinent au contraire que ces états sont régis par des déterminismes khaosiques immuables que nous ne connaissons pas et que nous ne pourrons probablement jamais connaître.
Jamais... ????
Cet état khaosique est qualifié par certain(e)s physicien(ne)s [ceux et celles qui adhèrent à cette théorie] de matière noire et d’énergie sombre [cf. 0.32.3].
2.3 Les notions contingentielles
Les principes, théories, postulats scientifiques appartiennent à la science. Si on désire approfondir certaines notions, thèses, théories, on se réfère à des auteurs scientifiques.
Nous retenons ici certaines lignes fortes issues des connaissances et recherches actuelles susceptibles d’alimenter notre grille d’analyse.
2.31 Que peut être la substance?
2.31.1 Les Particules
Notion métaphysique de substance, du latin «substare» = «ce qui se tient dessous».
Qu’est-ce qui se tient sous la matière perceptible par nos sensoirs? Réponse: des particules.
Qu’est-ce qui se tient sous l’énergie perceptible par nos sensoirs? Réponse: des ondes.
En 0.32.12, je renvois à l’article de Wikipédia traitant de la physique des particules. Les commentaires des censeurs invoquent un manque de références. On n’en tient pas compte car tout est là.
Interprétation de ce texte de Wiki:
-) On y cause du volet binaire de la substance: les particules dotées d’une structure particulière. Ce volet binaire est traité de 2.1 à 2.4. On ne va pas reprendre ces notions ici.
-) On y cause également du volet contingentiel: les interactions sont un mode de relation avec la notion de rapports. La relation, avec la puissance, constitue l’une des deux mamelles du Khaos comme le représente le tableau en 1.91 plus haut sur cette page. Les particules sont en contextes de rapports et d’interactions les unes avec les autres.
2.31.2 Les champs scalaires et vectoriels
Notion métaphysique de substance, du latin «substare» = «ce qui se tient dessous».
Qu’est-ce qui se tient dessous l’Univers? Un vaste espace infini et des segments d’espaces définis.
Référer à l’article dont le lien est fourni en 0.32.13.
On appelle «champ(s)» cet espace infini et les segments d’espaces objets de connaissances.
En Physique, l’article cité identifie les champs suivants:
les champs thermiques ou de températures,
les champs de pression,
les champs de densité,
les champs électriques,
les champs magnétiques,
les champs gravitationnels, etc…
On distingue également les champs scalaires des champs vectoriels.
Là encore, les censeurs de l’article exigent des précisions comme des dates. Certaines exigences sont exagérées. L’article s’avère déjà d’une digestion pénible sans en ajouter!
De retour à nos moutons, ces divers champs sont de l’ordre de la contingencité. Par contre les bosons et autres particules sont de l’ordre de la binarité.
2.32 Les angoisses existentielles des (méta)physiciens
2.32.1 La masse manquante
Notion métaphysique de substance, du latin «substare» = «ce qui se tient dessous».
Or parmi tout ce qui se tiendrait dessous, postule-t-on une masse manquante! Ainsi, 71% de toute l’énergie active dans l’univers serait manquante [énergie sombre] ainsi que 84% de toute la matière [matière noire]. Ces énergies et matières ne sont pas «in ou out»: elles existeraient mais de manière inconnaissable pour l’instant. N’appartiennent donc pas à l’ordre de la binarité [in/out] mais de la contingencité. Elles font également partie de la substance de l’Univers.
On peut référer à l’article de Wikipédia référé en 0.32.15.
2.32.2 La dualité particules / Ondes
On sait que tout objet naturel est matière/énergie. Le passage d’une forme à l’autre peut s’effectuer sans perte de masse si aucun travail n’est requis.
Le microcosmos est meublé de particules. Pendant microcosmique de la matière.
Phénomène étonnant, ces particules auraient des propriétés physiques d’une onde! Comme le pendant de l’énergie. Ainsi la lumière emprunterait la double forme d’un phénomène corpusculaire d’une part (photon); phénomène ondulatoire d’autre part (longueurs d’ondes).
Quand on est en contexte de CECI ET CELA, et non de CECI OU CELA, on est en contexte contingentiel.
On peut prendre connaissance de l’article dont le lien est offert en 0.32.5.
2.32.3 Probabilisme
De fait, une onde n’a pas de position précise. Si un(e) physicien(ne) observe un électron, en ce moment précis cet électron est ici. L’observation terminée, la forme ondulatoire surgit et rend incertaine sa future position. L’incertitude règne! Angoisse existentielle! Par de savants calculs cependant, notre physicien(ne)peut déterminer une position probabiliste future. Adieu les certitudes générées par les déterminismes implacables!
On oublie la binarité: ici également se trouve-t-on en contexte de contingencité.
Notions tirées du même article que cité ci-devant.
2.32.3 Singularité
Qu’est-ce qu’une singularité en Physique, surtout dans le domaine de la physique quantique?
C’est un Réel particulier inexplicable et pas comprenable: les Mathématiques y perdent le Nord; la Physique y perd le Sud; la Philosophie des sciences y perd l’Est; la métaphysique y perd l’Ouest. Les savantissimes mathématicien(e)s et physicien(ne)s y sont réduit(e)s à l’état frustrant d’ignares! État angoissant, n’est-il pas?
Par exemple, à son stade initial, notre maxicosmos se réduisait à un point infiniment petit mais doté d’une puissance énergétique infinie. On calcule cela comment? On explique cela comment? Peine perdue...
Puis ce fut le déclenchement de ce qui allait devenir notre maxicosmos, à partir de microcosmos, jusqu’à l’émergence des mezzocosmos dont les biosphères. Ce déclenchement initial s’explique comment? Personne n’en a la moindre idée.
La singularité telle que conçue par les physicien(ne)s n’est quand même pas à classer parmi les idéonomies [voir lien en 0.4 Terminaire] comme l’astrologie, la numérologie, voire les pseudo-métaphysiques aux assises surréalistes et fabulatrices. Il s’agit de méthodes scientifiques qui peinent à s’expliquer un Réel.
Le vocable s’origine du latin «Singularis» signifiant notamment “exceptionnel, extraordinaire, rare”. Ajoutons: tellement unique qu’inexplicable.
Commentons ici l’article rédigé par Hubert Reeves, astrophysiciens de réputation internationale. Le lien à son article est offert en 0.32.9
Hubert Reeves cite l’expression «Big-bang». C’est la planète astrophysicienne et par la suite médiatique des singes: tout le monde le dit, dis-le donc; tout le monde pense ainsi, pense donc ainsi.
D’une part, il s’agit là d’une métaphore un peu forte que son créateur – Fred Hoyle – a voulu ironique. On peut prendre connaissance du contexte dans l’article de Futura Science dont le lien est offert en 0.32.10.
D’autre part, des astrophysiciens refusent l’expression, parce que potentiellement fallacieuse. D’abord personne n’était là pour constater s’il s’agissait vraiment d’une explosion immensément retentissante... ou pas!
Surtout, tout ce beau monde scientifique cause de cet instant “0" mais refuse de se prononcer sur une genèse proposant un “avant” instant dit “0". Se peut-il que l’espace fut d’un vide infini? Mais revenons au québécois Hubert.
1) Le premier instant de l’Univers n’est pas un instant puisque le temps n’existe pas:{ t=0}.
2) Ce {t=0} apparaît comme une singularité, qualifiée de singularité initiale. C’est que l’on ne comprend pas bien cette situation initiale.
3) Le point originel serait caractérisé par une masse concentrée infinie dotée d’une puissance infinie. Comment cela se peut-il? Aucune idée! Vive la singularité initiale!
4) Cette explosion ou implosion ou éclosion ou quoi qu’il en soit, quel en fut l’élément déclencheur? Les théologiens et religieux de tous acabits y trouvent la justification de l’existence du divin.
Reeves opine que l’astrophysique n’a pas pour objet de prouver l’existence ou la non existence d’un divin. On peut se considérer comme astrophysicien et comme croyant, il n’y a pas de contradiction. L’astrophysique étudie le comment, pas le pourquoi... Il faut distinguer entre physique et métaphysique, dit-il!
Heuuuu... M. Reeves devrait également faire la différence entre philosophie et métaphysique.
La philosophie se donne comme mandat d’ergoter sur «toute pis rien pantoute», souvent dans une parlure qui oblige à traduire le verbiage comme s’il s’agissait d’une langue étrangère. La philosophie, c’est de l’idéologie. L’étude des pourquoi, c’est de l’idéologie.
La métaphysique n’est qu’une grille d’analyse inspirée par la science. «Listen to science», clame Greta Thunberg. La métaphysique authentique ne fait que cela.
Cette approche dominante se voit cependant questionnée notamment par Jean-Jacques Micalef, critique de la cosmologie du Big-bang, dans La Revue des Ressources dont on retrouve le lien ci-haut en 0.32.11.
Je considère son analyse comme de nature métaphysique pure, même si l’homme prétend rechercher les fondements “philosophiques” de la physique. L’auteur n’émet aucune théorie ou hypothèse: il analyse les prétentions des scientifiques. Voyons voir...
1) Selon la théorie de la singularité universelle ou Big-bang, l’espace-temps et la matière universelle auraient émergé du vide, du néant, du “nihil” absolu... Quelle cause physique aurait généré une telle explosion ou implosion ou éclosion ou quoi que ce soit qui ait pu générer et l’espace et le temps et la matière? Quelle en aurait été la procédure? Silence radio...
2) La question se pose: si hors de ce point originel c’était le vide, le néant, comment peut-on le savoir, voire le penser? On revient là dessus plus loin.
3) L’Univers est créé ou incréé? Si l’Univers fut créé par un divin quelconque, où était et que faisait ce divin avant la création? Devait mortellement s’ennuyer! Le problème avec ces approches théologiques, on confond Univers et création. Si le divin existe et qu’il est éternel, d’une puissance infinie, ce serait d’abord parce qu’IL EST! Il est un être, donc un Étant meublant l’Être universel. Autrement n’est pas. Ce faisant, il ferait de l’Univers un Réel éternel, d’une puissance infinie! [Cette dernière réflexion est la mienne, pas celle de l’auteur. Mais elle prolonge son doute quant à l’existence d’une création par un agent externe.]
4) L’espace-temps et la matière auraient surgi lors de cette fraction de nanoseconde qualifiée de Big-bang. Or cette singularité originelle pose problème! De se questionner l’auteur: comment la boule de feu originelle a pu s’extraire du néant? Poussons la réflexion plus loin.
Si la masse originelle s’est extirpée du néant, c’est que le néant existait! Or qu’entend-on par néant?
-) Si le néant est la non-existence de tout Étant, la boule énergétique originelle n’existait pas. Or elle existait, au dire de cette théorie du Big-bang. Quoi qu’il en soit, nous existons! Alors...
-) Si le néant n’est un espace vide parce que l’existence de la boule, c’est que l’espace existait avant le Big-bang!
-) Si l’espace vide existait avant le Big-bang, c’est que ce néant constituait un espace-temps précédant la micro-nanoseconde du Big-bang. Vint ensuite l’après Big-bang. Le temps préexistait! Un espace / temps peut-être d’une nature différente – on n’en sait rien!
5) Bref ce questionnement auquel ne répond pas l’hypothèse d’une singularité originale: cette SUBSTANCE originelle – parce que de substance s’agit-il – fauteur de ce cosmos qui est le nôtre, d’où provient-elle? Quel est son mode d’émergence? Dans le contexte de l’hypothèse de la singularité originelle, on ne se pose pas la question. Plus encore: cette substance était-elle de la nature d’une bouboule incandescente nano-microscopique ou au contraire, ce néant allégué n’était-il pas un Khaos doté de virtualités infinies? Dans le contexte de l’hypothèse de la singularité originelle, on ne se pose pas la question. Un(e) métaphysicien(ne) à la recherche de données scientifiques essentielles à l’élaboration de sa grille d’analyse se pose par contre ce genre de questions.
La singularité originelle... Discutable! Surtout que la bouboule originelle constitue la binarisation d’un état primaire. Or un état n’est pas de l’ordre de la binarité mais de la contingencité.
Pour la logique, vraiment, on repassera!
Il s’agit d’un constat d’indétermination de la relation entre la position d’une particule ET la mesure de la quantité de sa vitesse. Nous sommes toujours dans un contexte de contingencité. Comme cette indétermination est calculable, on parle alors de théorème. En le calculant, le théorème binarise cette indétermination. Le théorème simule l’information régissant un système indéterminé, un système non conformé.
Ce théorème n’est pas de compréhension aisée. On pourra prendre connaissance de l’article de Wikipédia cité en 0.32. 6, le plus abordable à mon sens.
Notons que ce théorème décrit des relations d’indétermination. En 1.91 plus haut, nous avons établi que la relation, avec la puissance, constituaient les propriétés inhérentes, intrinsèques du Khaos. Le Khaos est la mère de toutes les contingencités.
2.32.5 Nouvelles particules apparemment découvertes
Le fameux collisionneur européen de particules aurait découvert — ce qui reste à démontrer hors de tous doutes scientifiques — deux nouveaux baryons et possiblement un nouveau tétraquark.
Que sont ces trucs? Consulter l’article du CERN dont le lien est offert en 0.32.7
Démontrer l’existence réelle de ces trouvailles par des preuves incontestables, voilà un objet d’angoisses existentielles de nature scientifique. Angoisses que ne partagent certes pas les opérateurs de trains de métros qui, comme les bosons, fermions, baryons et autres bidules subatomiques, circulent dans des tunnels sous terre. À cela seulement se limite cependant cette comparaison...
~ III ~
LES POSTULATS
ONTOPHYSIQUES
Que devons-nous retenir de cet étalage de connaissances et hypothèses scientifiques?
Les quelques postulats qui suivent.
Avant cependant d’élaborer les quelques postulats que nous retenions pour cet article, nous allons d’abord rappeler les assises métaphysiques qui nous permettent de les fonder.
Les quelques postulats qui suivent.
Avant cependant d’élaborer les quelques postulats que nous retenions pour cet article, nous allons d’abord rappeler les assises métaphysiques qui nous permettent de les fonder.
3.1 Primarité ontologique de l’Étance contingentielle
Le Khaos tel que défini dans cet article se définit comme la substance d’où émergent les entités diverses – choses et phénomènes – sous l’action d’un principe moteur inhérent à l’Être universel que nous appelons ici ontarchie [pouvoir de l’Être universel].
L’ontarchie est le principe constituant de toutes entités en les faisant émerger du Khaos. Le modus operandi consiste à attribuer une structure et une organisation à un segment de “pouvant être” universel. Nous appelons ce “pouvant être” infini et indéterminé puissance.
Le Khaos est également relation infinie, à la fois rapports et interactions indéterminées. Ces rapports et interactions interagiront entre les éléments actués constituant des entités — choses ou phénomènes. Le principe ontarchique attribue également structures et organisations à ces Étances actuées, contribuant à générer des modèles de relations.
Puissance et relation sont infinies, jusqu’à ce que des segments ne soient actués et activés par le principe ontarchique. Les êtres ainsi créés sont de propriété finie.
Le Khaos constitue l’Étance contingentielle primaire de l’Être universel, parce que tout existant émerge de cette soupe cosmique. Nous causons de primarité ontologique.
3.2 Primarité noétique des étants binaires
Les animaux, incluant les humains, ne perçoivent que des configurations. Or toutes configurations sont des portions de potentiel actués. Une configuration peut être tangible, perçue par le toucher, le goût ou l’odorat.
Rappelons l’essentiel.
Les cerveaux des animaux sont constructivistes. Leurs sensoirs perçoivent des configurations qu’ils convertissent en signaux régis par des codes. Ces signaux codés constituent l’information régissant et la perception et la RE-présentation de l’objet perçu.
Les sensoirs des animaux perçoivent les objets de connaissance sous la tutelle de la téléonomie: cette perception est paramétrée par les besoins de chaque animal liés à sa survie. La vision qu’ont une abeille ou un taon d’une fleur n’est pas la même que celle d’un humain. Pour l’abeille, les couleurs de la fleur signifient “bouffe”; leurs corolles ressemblent à des pistes d’atterrissage. Pour l’humain, la fleur est objet de pâmoison...
Pour les herbivores, un gazon, c’est de la bouffe. Pour de nombreux humains, l’embellissement d’un terrain. Pour un amant de la diversité, un gazon résidentiel n’est qu’un pacage à vaches...
Les valeurs de beauté de chacun contribuent à teinter la perception esthétique que l’on se fait des objets... La diversité des valeurs esthétiques, c’est comme la biodiversité: la beauté de la contingencité...!
Pour l’ensemble de cette gent animalière, humains inclus, la perception des Étants binaires a statut de primarité noétique.
Qu’est-ce que la pensée? Une grille d’analyse est un produit de la pensée. Il importe donc de savoir de quoi l’on se cause!
Les acceptions accordées à ce vocable sèment une réelle confusion. Voyons voir de plus près. Nous tirons les acceptions suivantes du Lexus de Larousse.
Nous commentons ici les différentes acceptions retenues par le Lexus de Larousse.
-) Faculté de combiner des idées, de raisonner...
Cette faculté intellectuelle s’avère de fait une manière d’opérer d’un processeur mental que nous appelons “Intellect”. L’intellect est le pendant intellectif de l’instinct qui est un processeur lié à la perception et à l’action autonome. Les opérations de ce processeur ou faculté sont comparables aux opérations des processeurs informatiques, activités essentiellement “calculatrices”, donc d’ordre binaire.
Bref, la pensée serait de l’ordre de la binarité... On confond peut-être ici intellect et pensée!
-) Acte particulier de l’esprit qui se porte sur un objet...
Il s’agit d’un acte qui fasse en sorte que l’attention se porte sur un centre d’intérêt. Il s’agit donc de l’intellection d’un objet de connaissance, acte relevant également de l’intellect.
Cette activité consiste à porter son attention sur un objet à l’exclusion de tout autre, activité de l’ordre de la binarité également.
-) Idée, intention, projet...
Ces phénomènes sont le produit des activités constructivistes et représentationnelles du cerveau, donc des phénomènes binaires.
-) Sentence exprimée par quelqu’un...
Toutes sentences sont des produits des activités constructivistes et jugementielles du cerveau, donc des phénomènes binaires.
-) En pensée (expression)...
L’expression exprime l’idée d’une manière d’être d’une idée, d’un sentiment, d’une intention.
On a affaire ici à une Étance, une “ousia”. Donc de l’ordre de la contingencité. D’où confusion entre binarité et contingencité.
La question telle que posée renvoie à ce qu’est la pensée: une organisation, un système, un processus, un fonctionnement. Par conséquent de l’ordre de la contingencité. La binarisation de la pensée s’avère donc une errance!
Accorder aux vocables «pensée / penser» des acceptions liées aux notions d’idées, concepts, notions voire d’intellect constitue une errance lexicologique.
Ainsi, ce n’est pas parce qu’un couple maraîcher cultivent des navets que l’icelui et l’icelle sont des navets! De même, ce n’est pas parce que concepts, idées, notions et autres produits intellectuels procèdent, émergent de la pensée que celle-ci doit être confondue avec ceux-là!
Le vocable vient du latin «Pensare», un dérivé de «Pendere» dont le supin est «pensum».
Il y a l’acception latine du mot «Pensare»; il y a la réalité socio-économique sous-jacente au mot.
Au sens strict, le verbe signifie peser. Au sens métaphorique»: apprécier.
Le verbe peser fait référence à l’acte de peser un objet pour en déterminer la valeur: son poids et par extension sa valeur pécuniaire.
L’opération exige une balance, à savoir un système régi par un mécanisme.
On doit donc comprendre que peser exige un artefact, un mécanisme, un système de valeurs, bref une organisation.
L’acte de peser est une organisation, donc un système, un fonctionnement, des processus régis par l’information. De ce fait, appartient à l’ordre de la contingencité.
Penser est du même ordre. La pensée est une organisation, donc un système, un fonctionnement, des processus régis par l’information.
Nous établissons ici que la pensée constitue le volet contingentiel de cette faculté ou processeur intellectif qu’est l’intellect. Le tableau que voici:
Sous l’égide de l’intellect, la pensée joue le rôle de système opérationnel des mécanismes de représentation constructiviste des données émanant du Réel et emmagasinées dans les mémoires neuroniques.
L’intellect peut se comparer à un fureteur laser à la recherche des données enfouies dans les mémoires neuroniques.
La pensée est le résultat de cette cueillette de données issues des mémoires et des données émanant des sensoirs.
Elle est également cette opération qui consiste à ramasser ces données, les jauger, les peser et soupeser, les associer, les dissocier, finalement créer un ensemble auquel elle attribue une valeur. C’est la pensée jugementielle.
La pensée devient adhésion, conviction, croyance, sachance, accord, désaccord, opposition, acceptation, certitude, assurance, persuasion, détermination... bref toute une gamme d’Étances.
De cette activité émergent les notions, les concepts, les sentences, les préjugés, les idéologies, les doctrines, les diktats, les superstitions, les dogmes, opinions, théories et autres produits binaires de l’intellect.
Substance, répétons-le, désigne ce qui se tient sous l’objet – chose ou phénomène – observable par nos sensoirs, soit que la substance le fasse exister, soit qu’elle en constitue le contexte. “Ce qui se tient sous” n’est souvent perceptible qu’à l’aide d’artefacts. C’est le cas de la tension électrique cervicale.
On peut consulter l’article dont le lien est offert en 0.32.16: «Le cerveau, une centrale électrique». Voici un extrait:
La pensée, une activité essentiellement électrique, opère donc tant en contexte de conscience que de dormance, parce qu’à l’instar de l’instinct, l’intellect travaille constamment. Souvent mieux en état de dormance que de conscience. Nous trouvons souvent la solution à nos problématiques inextricables au beau milieu d’un bénéfique sommeil!
La pensée, c’est du traitement de données codées régies par l’information.
Pourquoi accorder autant d’importance à la pensée?
Parce que si on ne peut comprendre ce qu’est et comment fonctionne la pensée humaine, on ne peut comprendre ce qu’est et comment fonctionne une grille d’analyse, métaphysique ou autres. On raconte alors n’importe quoi! Errances généralisées chez moult doctorisé(e)s...
La constitution d’une grille d’analyse est une activité de la pensée humaine, donc d’ordre contingentiel.
Le tableau que voici:
Une grille d’analyse est un icone composé d’un volet binaire et d’un volet contingentiel. Dépendant que le volet primaire soit binaire ou contingentiel, l’icone sera binaire ou contingentiel.
Ce journel opte pour un volet contingentiel primaire. La grille d’analyse est donc conçue dans un contexte de contingencité.
Dans un contexte de binarité, les notions et concepts sont, pour ainsi dire, bunkérisés. Quelques exemples...
Depuis quelques décennies, les neurologues et autres spécialistes intéressé(e)s par la question maintenaient que la mémoire était le produit des interactions entre les neurones. Nombreux sont ceux et celles qui maintiennent toujours cette position. Sauf qu’il s’agissait d’une croyance détrônée par les trouvailles récentes de l’épigénétique!
Dans ce contexte, les notions binarisées, donc bunkérisées, priment sur un modèle de recherche aux apparences chimériques.
Kant est encore enseigné comme matière de base dans de nombreuses facultés de philosophie. Sa doctrine est figée, quoi que des commentateur(e)s s’efforcent de l’adapter. Se peut-il cependant que depuis bientôt trois cents ans, la science ait fait quelques progrès?
On pourrait en dire de même de Engels, Marx, Maritain, Sartre... Tous encore et toujours enseignés comme doctrine immuable et non sur une base historique.
Listen to science, proclame Greta Thunberg. Pour écouter la science faut-il suivre l’évolution de la pensée scientifique dans ce qu’elle a de plus actuelle. Dans un tel contexte, aucune notion n’est gélatinée pour les siècles.
Il importe donc de suivre l’évolution de la Physique dans toutes ses branches. Certaines évoluent très vite, telles la neurologie, la génétique et la cybernétique. La présente grille d’analyse “obéit” à l’évolution de la pensée scientifique.
Prenons l’exemple de la transgenrité.
De nombreux psychiatres et psychologues n’y voient qu’une errance de l’imaginaire. Ces professionnel(e)s sont contraint(e)s par leurs idéologies bien incrustées dans leurs prétendus savoir... Quand ils et elles ne sont pas contraint(e)s par leurs croyances religieuses.
Or certains généticien(ne)s semblent démontrer que cette perception de bigenrité serait fondée. Il s’agirait, au moment du développement du fœtus [ou avant], d’une errance chromosomique, affectant principalement le chromosome 49 dédié au développement sexuel.
Hypothèse plus que plausible. On sait que la reproduction chimique emprunte deux voies: stéréospécificité; stéréosélectivité. L’errance serait attribuable à un processus stéréosélectif: sélection d’un psychique et autres composantes somatiques d’un sexe; sélection de la génitalité de l’autre sexe. Cette interprétation demeure sujette à validation.
Listen to science... Avant de déclarer les bigenres victimes d’errances psychologiques, faut-il de nos jours questionner l’errance génétique!
Distinction fondamentale donc! Revenons à notre tableau.
Dans le contexte d’un icone contingentiel, les notions et concepts sont tributaires de l’évolution de la pensée scientifique; la pensée scientifique n’est pas contrainte par des notions et concepts bunkérisés. La présente grille d’analyse non plus!
Le tableau ci-contre illustre le parcours du réseau de perception des données perçues par les sensoirs. Le répartiteur de tout ce trafic a nom de système réticulaire ascendant.
3.42.1 Le cerveau reptilien
Les données perçues par les sensoirs sont acheminées vers le cerveau reptilien – le cervelet et le thalamus. L’information se rend également aux autres glandes meublant ce cerveau primitif.
De là, l’information est communiquée au cortex cérébral, question d’aller cueillir d’autres données mémorisées pour traiter l’information cueillie.
Cette perception va amener une réaction de premier niveau, à savoir immédiate. Cette réaction est de type affectif, dont émotif. Elle doit son existence au système nerveux sympathique pas toujours très sympathique.
Une réaction de second niveau, modifiés par le traitement des données mnémoniques peut susciter une correction de la réaction primaire. Et rétablir un certain rééquilibrage du stress généré. Cette activité est sous contrôle du système nerveux parasympathique.
Ces processus sont générés par une activité biochimique. Pour plus de détails, cf. le lien en 0.32.17.
Ce système est géré par l’instinct, de manière inconsciente. Tout ce que nous percevons de ce traitement biochimique et physiologique des données codées, ce sont les alertes que va générer l’instinct.
Pour les besoins du présent chapitre, c’est tout ce dont nous avons besoin de savoir.
3.42.2 L’encéphale
Une partie des données codées constituant l’information passe directement du côté de l’encéphale. Ce flux d’informations est alors pris en charge par cet autre processeur mental: l’intellect.
3.42.3 L’intellect représentationnel
Dans une première phase, l’intellect reconstruit les configurations de l’objet réel pour former l’objet mental. Cet objet mental peut emprunter une conformation réaliste — l’image — ou simulationnelle — symboles. Cette conformation permet d’accéder à un premier niveau d’entendement: la connaissance.
La connaissance d’un objet ne préjuge en rien de sa compréhension.
Cette connaissance peut également avoir subi l’influence des réactions du système nerveux sympathique.
Il s’agit donc d’un niveau d’intellection primaire qui ne débouche pas, à ce niveau, en la formation de jugements de faits ou de valeurs. Autrement dit, l’objet mental en adéquation (ou pas) avec l’objet réel n’est pas à ce stade intellectuellement intégré. Il s’agit d’un niveau de connaissance non réfléchi.
L’objectivité est une notion, également un concept. En tant que concept, elle est une simulation d’un processus mental.
Selon les dictionnaires, pour résumer toutes les définitions que l’on nous propose et qui d’ailleurs sont d’usage courant, l’objectivité consiste à porter un regard sur les objets réels – choses ou phénomènes – dépourvus de tous sentiments ou considérations subjectives. Dépourvus de toutes considérations subjectives [et non de toutes émotions subjectives], cette définition nous va de soi. Dépourvu de tous sentiments, une telle objectivité n’existe pas!
Revenons à notre description élaborée en 3.42.1. En enrichissant un tantinet le propos.
Quand, en traversant une rue, nous percevons un camion nous fonçant dessus, nous n’avons pas le camion dans le cerveau. Mais nous risquons que le camion nous passe dessus. La situation que voici.
L’objet réel ici est complexe: un camion, une rue...des objets; un danger, un environnement... des phénomènes. Ces perceptions sont des configurations d’objets et de phénomènes. Tous nos sens sont stimulés. Nos sensoirs collectent des données qu’ils approprient à leur traitement par le cerveau: mutations en signes et signaux codés qui seront acheminés d’une part au cerveau reptilien; d’autre part à l’encéphale.
La perception de ces objets de connaissance, tout objective fut-elle, baigne dans un contexte signé «alarme».
L’objet mental reconstruit par l’intellect, à ce stade de traitement de l’information, baigne dans un contexte d’alarme.
On peut revisiter notre section 1.96 portant sur l’objet mental. L’objet mental n’est pas une chose, un phénomène tangible, un étant. L’objet mental est une Étance qui n’existe que sur un support neurologique, comme l’image sur l’écran d’un téléviseur ou d’un ordinateur repose sur un support électronique. Or ce support neurologique est incontournablement affecté par l’état émotif de la personne.
L’objectivité doit être conçue comme un texte baignant dans un contexte interne et externe [revisiter la section 1.98 au besoin]. L’objectivité doit également être conçue comme un principe formel intellectif ayant pour objet l’adéquation de l’objet mental à l’objet réel [revisiter la section 1.91 au besoin].
Une objectivité ainsi conçue ne peut servir de plateforme à une grille d’analyse d’inspiration scientifique.
3.42.5 Un cas d’objectivité qui déraille...
Les objets de connaissance peuvent être des choses ou des phénomènes. Les phénomènes peuvent être tangibles comme les éclairs ou intangibles comme des phénomènes sociaux. Un phénomène est un événement ou incident qui survient. L’incident que voici, mettant en vedette Greta Thunberg de réputation maintenant internationale.
La photo ci-contre montre Greta assise par terre lors de son retour de voyage vers la maison. La photo s’accompagne du commentaire suivant:
L’histoire est racontée dans le journal “Insider” dont le lien est offert en 0.32.18. Le journal rapporte la réponse de la compagnie ferroviaire en ces termes:
Bref, sur la base d’un fait apparemment factuel, la compagnie a pris ce commentaire comme une critique négative. Tout est très objectif dans cette histoire. La réponse de la compagnie, laissant percer un brin de frustration, demeure apparemment légitimée par un objet réel tangible: une photo. L’image mentale qui fut celle de l’intervenant de la compagnie obéit-elle au principe d’objectivité? Réponse plus bas...
3.42.6 L’intellect réflexif
À un second niveau, l’intellect assimile les données, opérations permettant de générer les jugements de faits et de valeurs. L’objet mental se mute en sujet mental.
Tout ce processus a nom de réflexion. La pensée devient réflexive. Le produit de cette pensée devient par le fait même subjectif.
La pensée subjective est régie par la subjectivité, comme le suggère le tableau que voici:
Les jugements de faits comme de valeurs, sans grilles d’analyse d’inspiration scientifique, peuvent s’avérer fallacieux, paralogiques, métaphoriquement déraillés! Le présent exemple de tels jugements tiré de la trotte de Greta Thunberg, retour à la maison en décembre 2019, en train, sur rails, déraillés... Kapish?
3.42.7 Distinctions entre constats et jugements
La signification que l’on accorde au mot «jugement» va dans tous les sens. Pour résumer cependant, disons que le jugement de fait serait objectif alors que le jugement de valeurs serait pour sa part subjectif. Or on soutient une telle errance en nombre de facultés universitaires ainsi que dans la littérature.
Source de l’errance: la confusion entre «constat» et «jugement».
Le constat est objectif, en ce sens qu’il porte un regard sur l’objet de connaissance. La pomme est un fruit. Au moment d’écrire ces lignes, Donald Trump vient de se voir livré à un “impeachment” par la Chambre des représentants du Congrès usois. Greta Thunberg est une activiste invitée un peu partout en Occident. L’achat de voitures électriques au Québec prend de l’ampleur. Un cheval blanc est un bel animal...
Tout ce que l’on demande à un constat, c’est d’être en adéquation avec l’objet réel, du moins autant que possible. Il n’y a pas de vrai ou de faux en matière de constats. Je ne peux nier que le pape catholique porte un accoutrement blanc. Ou qu’il soit vrai ou faux que Justin Trudeau et famille se soient promenés en accoutrements indiens lors d’un voyage en Inde: les photos le prouvent!
Le jugement implique des considérations personnelles. Le jugement compare et juge, ce à deux niveaux: jugements de faits et jugements de valeurs.
Plus encore: contrairement au constat, le jugement interprète les données perçues.
3.42.8 Jugements de faits
Le jugement de fait est régi par le principe de subjectivité, et non d’objectivité.
Il pose un jugement interprétatif sur les objets mentaux. Souvent s’agit-il d’un jugement erroné. La fameuse trotte en train de Greta Thunberg, assise sur le plancher d’un wagon: la photo ci-contre.
La compagnie ferroviaire a pris cette image comme un critique de la qualité de son service. Un(e) responsable a gazouillé ce qui suit (traduction):
La compagnie a définitivement mésinterprété son billet sur Facebook et l’équivalent sur Twitter. Un jugement de fait qui a déraillé...
Greta a également, lors d’une intervention publique à Turin, soutenu ce qui suit [voir lien à l’article 0.32.20]:
Émis sans l’apport d’une grille d’analyse logiquement fondée, à l’abri des paralogismes et des erreurs d’interprétation, les jugements de faits s’avèrent trop souvent erratiques.
Les valeurs de beauté de chacun contribuent à teinter la perception esthétique que l’on se fait des objets... La diversité des valeurs esthétiques, c’est comme la biodiversité: la beauté de la contingencité...!
Pour l’ensemble de cette gent animalière, humains inclus, la perception des Étants binaires a statut de primarité noétique.
3.3 La pensée comme Étance contingentielle
Qu’est-ce que la pensée? Une grille d’analyse est un produit de la pensée. Il importe donc de savoir de quoi l’on se cause!
Les acceptions accordées à ce vocable sèment une réelle confusion. Voyons voir de plus près. Nous tirons les acceptions suivantes du Lexus de Larousse.
3.31 Ce qu’en pense le Lexus
Nous commentons ici les différentes acceptions retenues par le Lexus de Larousse.
-) Faculté de combiner des idées, de raisonner...
Cette faculté intellectuelle s’avère de fait une manière d’opérer d’un processeur mental que nous appelons “Intellect”. L’intellect est le pendant intellectif de l’instinct qui est un processeur lié à la perception et à l’action autonome. Les opérations de ce processeur ou faculté sont comparables aux opérations des processeurs informatiques, activités essentiellement “calculatrices”, donc d’ordre binaire.
Bref, la pensée serait de l’ordre de la binarité... On confond peut-être ici intellect et pensée!
-) Acte particulier de l’esprit qui se porte sur un objet...
Il s’agit d’un acte qui fasse en sorte que l’attention se porte sur un centre d’intérêt. Il s’agit donc de l’intellection d’un objet de connaissance, acte relevant également de l’intellect.
Cette activité consiste à porter son attention sur un objet à l’exclusion de tout autre, activité de l’ordre de la binarité également.
-) Idée, intention, projet...
Ces phénomènes sont le produit des activités constructivistes et représentationnelles du cerveau, donc des phénomènes binaires.
-) Sentence exprimée par quelqu’un...
Toutes sentences sont des produits des activités constructivistes et jugementielles du cerveau, donc des phénomènes binaires.
-) En pensée (expression)...
L’expression exprime l’idée d’une manière d’être d’une idée, d’un sentiment, d’une intention.
On a affaire ici à une Étance, une “ousia”. Donc de l’ordre de la contingencité. D’où confusion entre binarité et contingencité.
3.32 Qu’en penser?
La question telle que posée renvoie à ce qu’est la pensée: une organisation, un système, un processus, un fonctionnement. Par conséquent de l’ordre de la contingencité. La binarisation de la pensée s’avère donc une errance!
Accorder aux vocables «pensée / penser» des acceptions liées aux notions d’idées, concepts, notions voire d’intellect constitue une errance lexicologique.
Ainsi, ce n’est pas parce qu’un couple maraîcher cultivent des navets que l’icelui et l’icelle sont des navets! De même, ce n’est pas parce que concepts, idées, notions et autres produits intellectuels procèdent, émergent de la pensée que celle-ci doit être confondue avec ceux-là!
3.33 Qu’est-ce que penser?
Le vocable vient du latin «Pensare», un dérivé de «Pendere» dont le supin est «pensum».
Il y a l’acception latine du mot «Pensare»; il y a la réalité socio-économique sous-jacente au mot.
Au sens strict, le verbe signifie peser. Au sens métaphorique»: apprécier.
Le verbe peser fait référence à l’acte de peser un objet pour en déterminer la valeur: son poids et par extension sa valeur pécuniaire.
L’opération exige une balance, à savoir un système régi par un mécanisme.
On doit donc comprendre que peser exige un artefact, un mécanisme, un système de valeurs, bref une organisation.
L’acte de peser est une organisation, donc un système, un fonctionnement, des processus régis par l’information. De ce fait, appartient à l’ordre de la contingencité.
Penser est du même ordre. La pensée est une organisation, donc un système, un fonctionnement, des processus régis par l’information.
Nous établissons ici que la pensée constitue le volet contingentiel de cette faculté ou processeur intellectif qu’est l’intellect. Le tableau que voici:
Sous l’égide de l’intellect, la pensée joue le rôle de système opérationnel des mécanismes de représentation constructiviste des données émanant du Réel et emmagasinées dans les mémoires neuroniques.
3.34 La pensée: le fonctionnement d’un fureteur laser
L’intellect peut se comparer à un fureteur laser à la recherche des données enfouies dans les mémoires neuroniques.
La pensée est le résultat de cette cueillette de données issues des mémoires et des données émanant des sensoirs.
Elle est également cette opération qui consiste à ramasser ces données, les jauger, les peser et soupeser, les associer, les dissocier, finalement créer un ensemble auquel elle attribue une valeur. C’est la pensée jugementielle.
La pensée devient adhésion, conviction, croyance, sachance, accord, désaccord, opposition, acceptation, certitude, assurance, persuasion, détermination... bref toute une gamme d’Étances.
De cette activité émergent les notions, les concepts, les sentences, les préjugés, les idéologies, les doctrines, les diktats, les superstitions, les dogmes, opinions, théories et autres produits binaires de l’intellect.
3.35 La tension électrique, substance alimentant la pensée
Substance, répétons-le, désigne ce qui se tient sous l’objet – chose ou phénomène – observable par nos sensoirs, soit que la substance le fasse exister, soit qu’elle en constitue le contexte. “Ce qui se tient sous” n’est souvent perceptible qu’à l’aide d’artefacts. C’est le cas de la tension électrique cervicale.
On peut consulter l’article dont le lien est offert en 0.32.16: «Le cerveau, une centrale électrique». Voici un extrait:
La tension mesure l’intensité avec laquelle le cerveau répond à un stimulus qui, à son tour, influe sur la capacité du cerveau à traiter cette information (aussi bien cognitive que physique). Cette tension est également appelée différence de potentiel. Elle détermine le métabolisme et les divers états de conscience, de « pleinement éveillé » à « profondément endormi ». Sans tension adéquate, vous fonctionnez au ralenti.
La pensée, une activité essentiellement électrique, opère donc tant en contexte de conscience que de dormance, parce qu’à l’instar de l’instinct, l’intellect travaille constamment. Souvent mieux en état de dormance que de conscience. Nous trouvons souvent la solution à nos problématiques inextricables au beau milieu d’un bénéfique sommeil!
La pensée, c’est du traitement de données codées régies par l’information.
3.36 Une grille d’analyse: fruit de la pensée
Pourquoi accorder autant d’importance à la pensée?
Parce que si on ne peut comprendre ce qu’est et comment fonctionne la pensée humaine, on ne peut comprendre ce qu’est et comment fonctionne une grille d’analyse, métaphysique ou autres. On raconte alors n’importe quoi! Errances généralisées chez moult doctorisé(e)s...
3.4 Éléments constituants
de la présente grille d’analyse
La constitution d’une grille d’analyse est une activité de la pensée humaine, donc d’ordre contingentiel.
3.41 Une grille d’analyse: produit de la pensée scientifique
Le tableau que voici:
Une grille d’analyse est un icone composé d’un volet binaire et d’un volet contingentiel. Dépendant que le volet primaire soit binaire ou contingentiel, l’icone sera binaire ou contingentiel.
Ce journel opte pour un volet contingentiel primaire. La grille d’analyse est donc conçue dans un contexte de contingencité.
Dans un contexte de binarité, les notions et concepts sont, pour ainsi dire, bunkérisés. Quelques exemples...
Depuis quelques décennies, les neurologues et autres spécialistes intéressé(e)s par la question maintenaient que la mémoire était le produit des interactions entre les neurones. Nombreux sont ceux et celles qui maintiennent toujours cette position. Sauf qu’il s’agissait d’une croyance détrônée par les trouvailles récentes de l’épigénétique!
Dans ce contexte, les notions binarisées, donc bunkérisées, priment sur un modèle de recherche aux apparences chimériques.
Kant est encore enseigné comme matière de base dans de nombreuses facultés de philosophie. Sa doctrine est figée, quoi que des commentateur(e)s s’efforcent de l’adapter. Se peut-il cependant que depuis bientôt trois cents ans, la science ait fait quelques progrès?
On pourrait en dire de même de Engels, Marx, Maritain, Sartre... Tous encore et toujours enseignés comme doctrine immuable et non sur une base historique.
Listen to science, proclame Greta Thunberg. Pour écouter la science faut-il suivre l’évolution de la pensée scientifique dans ce qu’elle a de plus actuelle. Dans un tel contexte, aucune notion n’est gélatinée pour les siècles.
Il importe donc de suivre l’évolution de la Physique dans toutes ses branches. Certaines évoluent très vite, telles la neurologie, la génétique et la cybernétique. La présente grille d’analyse “obéit” à l’évolution de la pensée scientifique.
Prenons l’exemple de la transgenrité.
De nombreux psychiatres et psychologues n’y voient qu’une errance de l’imaginaire. Ces professionnel(e)s sont contraint(e)s par leurs idéologies bien incrustées dans leurs prétendus savoir... Quand ils et elles ne sont pas contraint(e)s par leurs croyances religieuses.
Or certains généticien(ne)s semblent démontrer que cette perception de bigenrité serait fondée. Il s’agirait, au moment du développement du fœtus [ou avant], d’une errance chromosomique, affectant principalement le chromosome 49 dédié au développement sexuel.
Hypothèse plus que plausible. On sait que la reproduction chimique emprunte deux voies: stéréospécificité; stéréosélectivité. L’errance serait attribuable à un processus stéréosélectif: sélection d’un psychique et autres composantes somatiques d’un sexe; sélection de la génitalité de l’autre sexe. Cette interprétation demeure sujette à validation.
Listen to science... Avant de déclarer les bigenres victimes d’errances psychologiques, faut-il de nos jours questionner l’errance génétique!
Distinction fondamentale donc! Revenons à notre tableau.
Dans le contexte d’un icone contingentiel, les notions et concepts sont tributaires de l’évolution de la pensée scientifique; la pensée scientifique n’est pas contrainte par des notions et concepts bunkérisés. La présente grille d’analyse non plus!
3.42: Les deux niveaux de perception
Le tableau ci-contre illustre le parcours du réseau de perception des données perçues par les sensoirs. Le répartiteur de tout ce trafic a nom de système réticulaire ascendant.
3.42.1 Le cerveau reptilien
Les données perçues par les sensoirs sont acheminées vers le cerveau reptilien – le cervelet et le thalamus. L’information se rend également aux autres glandes meublant ce cerveau primitif.
De là, l’information est communiquée au cortex cérébral, question d’aller cueillir d’autres données mémorisées pour traiter l’information cueillie.
Une réaction de second niveau, modifiés par le traitement des données mnémoniques peut susciter une correction de la réaction primaire. Et rétablir un certain rééquilibrage du stress généré. Cette activité est sous contrôle du système nerveux parasympathique.
Ces processus sont générés par une activité biochimique. Pour plus de détails, cf. le lien en 0.32.17.
Ce système est géré par l’instinct, de manière inconsciente. Tout ce que nous percevons de ce traitement biochimique et physiologique des données codées, ce sont les alertes que va générer l’instinct.
Pour les besoins du présent chapitre, c’est tout ce dont nous avons besoin de savoir.
3.42.2 L’encéphale
Une partie des données codées constituant l’information passe directement du côté de l’encéphale. Ce flux d’informations est alors pris en charge par cet autre processeur mental: l’intellect.
Dans une première phase, l’intellect reconstruit les configurations de l’objet réel pour former l’objet mental. Cet objet mental peut emprunter une conformation réaliste — l’image — ou simulationnelle — symboles. Cette conformation permet d’accéder à un premier niveau d’entendement: la connaissance.
La connaissance d’un objet ne préjuge en rien de sa compréhension.
Cette connaissance peut également avoir subi l’influence des réactions du système nerveux sympathique.
Il s’agit donc d’un niveau d’intellection primaire qui ne débouche pas, à ce niveau, en la formation de jugements de faits ou de valeurs. Autrement dit, l’objet mental en adéquation (ou pas) avec l’objet réel n’est pas à ce stade intellectuellement intégré. Il s’agit d’un niveau de connaissance non réfléchi.
3.42.4 Notion d’objectivité
Le tableau que voici:
Le tableau que voici:
L’objectivité est une notion, également un concept. En tant que concept, elle est une simulation d’un processus mental.
Selon les dictionnaires, pour résumer toutes les définitions que l’on nous propose et qui d’ailleurs sont d’usage courant, l’objectivité consiste à porter un regard sur les objets réels – choses ou phénomènes – dépourvus de tous sentiments ou considérations subjectives. Dépourvus de toutes considérations subjectives [et non de toutes émotions subjectives], cette définition nous va de soi. Dépourvu de tous sentiments, une telle objectivité n’existe pas!
Revenons à notre description élaborée en 3.42.1. En enrichissant un tantinet le propos.
Quand, en traversant une rue, nous percevons un camion nous fonçant dessus, nous n’avons pas le camion dans le cerveau. Mais nous risquons que le camion nous passe dessus. La situation que voici.
La perception de ces objets de connaissance, tout objective fut-elle, baigne dans un contexte signé «alarme».
L’objet mental reconstruit par l’intellect, à ce stade de traitement de l’information, baigne dans un contexte d’alarme.
On peut revisiter notre section 1.96 portant sur l’objet mental. L’objet mental n’est pas une chose, un phénomène tangible, un étant. L’objet mental est une Étance qui n’existe que sur un support neurologique, comme l’image sur l’écran d’un téléviseur ou d’un ordinateur repose sur un support électronique. Or ce support neurologique est incontournablement affecté par l’état émotif de la personne.
L’objectivité doit être conçue comme un texte baignant dans un contexte interne et externe [revisiter la section 1.98 au besoin]. L’objectivité doit également être conçue comme un principe formel intellectif ayant pour objet l’adéquation de l’objet mental à l’objet réel [revisiter la section 1.91 au besoin].
Une objectivité ainsi conçue ne peut servir de plateforme à une grille d’analyse d’inspiration scientifique.
Les objets de connaissance peuvent être des choses ou des phénomènes. Les phénomènes peuvent être tangibles comme les éclairs ou intangibles comme des phénomènes sociaux. Un phénomène est un événement ou incident qui survient. L’incident que voici, mettant en vedette Greta Thunberg de réputation maintenant internationale.
Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home!
L’histoire est racontée dans le journal “Insider” dont le lien est offert en 0.32.18. Le journal rapporte la réponse de la compagnie ferroviaire en ces termes:
The German rail operator Deutsche Bahn responded to Thunberg noting that she had not praised its "friendly" and "competent" team and appearing to suggest that the photograph was staged by mentioning Thunberg had a first-class seat on the train.
Bref, sur la base d’un fait apparemment factuel, la compagnie a pris ce commentaire comme une critique négative. Tout est très objectif dans cette histoire. La réponse de la compagnie, laissant percer un brin de frustration, demeure apparemment légitimée par un objet réel tangible: une photo. L’image mentale qui fut celle de l’intervenant de la compagnie obéit-elle au principe d’objectivité? Réponse plus bas...
3.42.6 L’intellect réflexif
À un second niveau, l’intellect assimile les données, opérations permettant de générer les jugements de faits et de valeurs. L’objet mental se mute en sujet mental.
Tout ce processus a nom de réflexion. La pensée devient réflexive. Le produit de cette pensée devient par le fait même subjectif.
La pensée subjective est régie par la subjectivité, comme le suggère le tableau que voici:
Les jugements de faits comme de valeurs, sans grilles d’analyse d’inspiration scientifique, peuvent s’avérer fallacieux, paralogiques, métaphoriquement déraillés! Le présent exemple de tels jugements tiré de la trotte de Greta Thunberg, retour à la maison en décembre 2019, en train, sur rails, déraillés... Kapish?
3.42.7 Distinctions entre constats et jugements
La signification que l’on accorde au mot «jugement» va dans tous les sens. Pour résumer cependant, disons que le jugement de fait serait objectif alors que le jugement de valeurs serait pour sa part subjectif. Or on soutient une telle errance en nombre de facultés universitaires ainsi que dans la littérature.
Source de l’errance: la confusion entre «constat» et «jugement».
Tout ce que l’on demande à un constat, c’est d’être en adéquation avec l’objet réel, du moins autant que possible. Il n’y a pas de vrai ou de faux en matière de constats. Je ne peux nier que le pape catholique porte un accoutrement blanc. Ou qu’il soit vrai ou faux que Justin Trudeau et famille se soient promenés en accoutrements indiens lors d’un voyage en Inde: les photos le prouvent!
Le jugement implique des considérations personnelles. Le jugement compare et juge, ce à deux niveaux: jugements de faits et jugements de valeurs.
Plus encore: contrairement au constat, le jugement interprète les données perçues.
Le jugement de fait est régi par le principe de subjectivité, et non d’objectivité.
Il pose un jugement interprétatif sur les objets mentaux. Souvent s’agit-il d’un jugement erroné. La fameuse trotte en train de Greta Thunberg, assise sur le plancher d’un wagon: la photo ci-contre.
La compagnie ferroviaire a pris cette image comme un critique de la qualité de son service. Un(e) responsable a gazouillé ce qui suit (traduction):
Chère Greta, merci pour votre soutien aux employés des chemins de fer dans notre combat contre le changement climatique. Nous sommes contents que vous ayez voyagé sur le ICE 174 (train à grande vitesse) samedi. Il aurait été plus gentil si vous aviez également fait mention de la façon aimable et compétente dont vous avez été traitée par notre personnel en première classe.La flicka a répondu:
Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat. This is no problem of course and I never said it was.
La compagnie a définitivement mésinterprété son billet sur Facebook et l’équivalent sur Twitter. Un jugement de fait qui a déraillé...
We will make sure we put world leaders against the wall' if they do not tackle global warmingCe passage a fait un scandale en certains milieux, interprétant ce message comme une invitation à la violence. Ce à quoi la flicka a répondu:
Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.Autre exemple d’un jugement de faits interprétatif hors contexte absolument dans le champ!
That’s what happens when you improvise speeches in a second language.
But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I - as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway.
Greta Thunberg, 14/12/2019
Émis sans l’apport d’une grille d’analyse logiquement fondée, à l’abri des paralogismes et des erreurs d’interprétation, les jugements de faits s’avèrent trop souvent erratiques.
3.42.9 Jugements de valeurs
En interprétant les intentions de Greta, la compagnie a non seulement erré quant aux faits mais également quant aux valeurs en cause: il se serait agi d’une critique du service ferroviaire de la firme allemande. Or Greta, 16 ans seulement rappelons-nous, a remis les pendules à l’heure.
À l’intention de la compagnie:
À l’intention des journalistes:
On peut bien causer de jugements de valeurs; encore faut-il s’entendre sur la notion de valeurs. On pourra consulter à ce sujet notre article «L’intentionnalité universelle», chapitre 2.44.25 à 2.44.32. Nous retenons ici les sections 2.44.26 et 2.44.27 portant sur les valeurs binaires et contingentielles. Le lien est offert en 0.210.
Les valeurs contingentielles contraignent autrement.
Ces valeurs émergent de contextes particuliers et en cela, adoptent le principe métaphysique établissant le postulat que voici:
Rien n'a de sens en dehors d'un contexte
Le sens constitue la substance, l’assise de la valeur contingentielle.
Les valeurs contingentielles n’ont rien à voir avec les absolus: le sens qu’elles véhiculent est fondamentalement et essentiellement relatif aux contextes d’où elles émergent.
On se cause alors de valeurs relativistes.
Les postulats s’inspirent à la fois de la cybermétaphysique – inspirée de la mouvance cybernétique de 2ème génération – et de l’ontophysique – inspirée de la mouvance aristotélicienne.
L’analyse jugementielle est de type contingentiel.
Nous avons établi que tout objet de connaissance est un icone doté d’un volet primaire et complémentaire. Il importe alors de déterminer la primarité et complémentarité iconiques de tout icone.
L’analyse doit cependant porter en priorité sur la substance et le contexte, donc le volet contingentiel de l’objet puisque ce volet est l’outil basique de compréhension du dit objet.
3.503 Postulat
Par macrostructure, on entend les structures qui permettent la configuration d’une entité.
Par entité, on entend une portion de puissance ou prototype actuée, appartenant au réel tangible.
Toute analyse doit porter sur un objet de connaissance existant en tant qu’entité. On ne peut analyser des possibles dont on ignore tout. Genre: discuter du sexe des anges! Soyons davantage explicites: analyser en profondeur des mythes fondateurs qui ne sont que fictions est à classer parmi les pertes de temps.
Par essence, une organisation se particularise par les systèmes, les fonctionnements, les processus qui la caractérisent. Tout système est régi par l’information.
L’information, comportant données perçues et codes, constitue l’infrastructure de l’objet mental, lequel se définit comme une organisation de la pensée.
L’information régit également et plus fondamentalement les systèmes évoluant dans l’Univers. L’information constitue également l’infrastructure de l’Univers conçu comme organisation.
Il importe d’amorcer l’analyse initiale d’un objet de connaissance par l’étude des systèmes, processus, fonctionnements sous-jacents à l’objet réel. Les systèmes, processus, fonctionnements constituent le contexte d’un objet de connaissance dont il est question plus bas en 3.506.
Un texte induit l’idée d’une construction par entrelacement, association, assimilation de composantes.
Un texte d’une part est le produit du tissage de composantes pour former un tout: c’est le volet texture. Les composantes incluent ce qui est perceptible par nos sensoirs mais également la substance sous-jacente à tout objet réel.
Un texte est limité par sa tessiture: hauteur, largeur, profondeur, portée, impact, etc.
L’analyse doit d’abord porter sur la tessiture d’un texte pour en déterminer les limites, la profondeur. Cette approche permet de se tenir à distance des absolutismes d’une part, d’une sous-évaluation d’autre part. Une juste analyse de la texture devrait en découler.
Tout texte émerge d’un contexte. Le contexte constitue l’environnement interne et externe d’un texte.
La signifiance d’un objet de connaissance provient du texte constituant cet objet.
Le sens d’un objet de connaissance est livré par le contexte.
L’analyse du contexte doit primer sur toutes autres tâches analytiques. L’analyse d’un vocable par exemple commence par son historique avant de procéder à la validation des diverses acceptions. L’analyse d’un objet réel physique tout autant qu’appartenant à la biosphère commence par l’étude de sa morphogenèse d’une part, de son environnement actuel d’autre part.
L’analyse est d’abord quête de sens avant de s’engager dans une quête de signifiance. Ainsi doit procéder une analyse qui privilégie la contingentialité des objets de connaissance.
Ci-haut, 0.209, le lien est offert vers notre article portant sur la notion de catégorie. Les chapitres 1.2 et 1.3, décrivent les notions de stéréospécificité et stéréosélectivité. Le chapitre 2.2 décrit les incompatibilités de nature. Nous allons retenir ici quelques notions pour illustrer notre propos.
Commençons par le principe logique d’incompatibilité catégoriale. Ce principe s’exprime ainsi:
Qu’est-ce que la stéréospécificité?
Appliquons!
L’intelligence désigne l’activité spécifique ainsi que le produit d’un processeur humain: l’intellect. L’intelligence appartient par nature à la catégorie «biosphère», sous-catégorie «animalité», sous-sous-catégorie «humanité».
La transmission de l’intelligence est de nature stéréospécifique et non stéréosélectif.
Il est impossible que la génétique humaine puisse choisir entre transmettre cette faculté à un cerveau humain ou à un artefact électronique.
Les artefacts électroniques appartiennent à une autre catégorie d’objets, incompatibles avec l’intelligence humaine.
Généraliser l’expression «intelligence artificielle» constitue rien moins qu’une aberration logique concoctée par des cancres en matière de logique – fussent-ils et elles des doctorisé(e)s – qui se prennent pour des Igor Mel’čuk(2)! On argue qu’il s’agit d’une métaphore. Désolé pour la métaphore: elle constitue une insulte à l’intelligence réelle.
Sauf que, voyons-nous, sur la planète anthropoïde des singes, «tout le monde le dit, dites-le donc»! Alors...
Cette aberration logique n’entraîne cependant aucunes conséquences vraiment dommageables. Il n’en est pas toujours ainsi. D’où l’importance de faire ressortir les rectitudes ou errances logiques.
Quelqu’un(e) quelque part pourrait rétorquer que dans ce journel, nous pratiquons le même genre de métaphore en utilisant l’expression «bio-ordinateur cérébral». Nous y établissons donc un lien entre un artefact et un cerveau humain. Sauf que, pas pareil!
Le vocable «ordinateur» vient du latin dit impérial signifiant «qui régit, ordonne, organise». Sous la tutelle de ce processeur ou faculté qu’est l’intellect, c’est ce que le cerveau accomplit: régir, organiser, mettre de l’ordre dans les connaissances acquises.
Plus encore, ce bio-ordinateur «formate» les comportements humains pour incruster des attitudes qui deviennent permanentes et que l’on appelle en métaphysique «habitus». Il ne s’agit donc pas d’une métaphore mais d’un usage approprié du vocable «bio-ordinateur».
On peut au besoin revisiter le chapitre 1.4 du présent article.
Par ordre, on entend les manières d’être, d’agir, de se comporter, d’évoluer de tous les objets meublant l’Univers.
Ces «Étances» sont régies par ce que nous avons dénommé les «Nomies».
Ces nomies comportent quatre sous-ordres: téléonomie, déontonomie, typonomie et kinètonomie.
Typonomie et kinètonomie s’avèrent très importantes pour l’analyse de la morphogenèse des objets de connaissance.
Téléonomie et déontonomie font ressentir leurs importances dans l’étude du Droit naturel, conséquemment des droits humains.
Un dicton très fréquent, surtout en politique: «La perception, c’est la réalité». Ce n’est pas parce que ce dicton est répété par tout un chacun qu’il s’avère fondé. De fait, cette réalité à soi peut s’avérer tronquée par les préjugés, les croyances et crédulités, l’idéologie, les fictions des personnes, voire s’avérer totalement fallacieuses. Il faut donc s’entendre sur la notion de réalité.
La réalité n’est pas le Réel. Quand je pense éléphant, je n’ai pas la bête dans le cerveau. Je n’ai que la reconstitution de la configuration de la bête sous forme de représentation: image ou simulation. L’adéquation de la réalité au Réel dépend de la qualité de cette représentation. La perception mentale d’un éléphant rose suggère un problème d’adéquation au Réel...
Bref, la première qualité de la réalité est de s’avérer réaliste!
Il en est ainsi de la représentation de toutes choses et phénomènes qui crée la réalité d’un individu.
Ainsi, en décembre 2019, 54% des Britanniques opinaient que le brexit à tout prix était réaliste. 46% soutenaient le contraire. La perception serait la réalité: quelle réalité? Le P.M. Johnson ayant été réélu avec une majorité suffisante, le brexit aura lieu. Une fois consommé, sera réalité effective. Sera pour autant réaliste?
Une analyse rationnelle doit se méfier des dictons populaires... La réalité n’est pas une représentation mentale binaire mais contingentielle. Et la contingencité laisse peu de place aux absolus...
Le constat est une représentation mentale objective d’un objet de connaissance lié à l’objet mental – d’où le fait qu’il soit considéré comme objectif. Le constat demeure dépendant des conditions liées à la perception de l’objet réel: états émotionnels de la personne, contextes, angles de perception, tessiture [ampleur et profondeur] de la perception [un professionnel dans un domaine va percevoir plus d’informations concernant un objet qu’un individu profane en la matière].
C’est là qu’entre en jeu l’analyse qui a pour objet l’élimination des “bruits” affectant l’information. Le jugement qui en découle tend à rétablir les faits dans une optique plus neutre. Ce point de vue est cependant celui d’un sujet pensant, donc assujetti au principe de subjectivité.
La validité et la solidité d’un jugement de fait sont tributaires de la qualité de la grille d’analyse appliquée.
Les jugements de valeurs doivent prendre leurs assises sur les jugements de faits. Le tableau que voici:
Il est d’abord évident que si les jugements de faits véhiculent des errements – voire des aberrations, aucun jugement de valeurs ne pourra s’avérer fondé.
Des jugements de valeurs fondés doivent prendre en considération les quatre sous-ordres nomiques: typonomie, kinètonomie, téléonomie et déontonomie. L’analyse de ces nomies vont permettre d’évaluer la nature de l’objet, sa morphogenèse, son évolution, ses contraintes, ses finalités.
Cette approche est contingentielle et de nature spécifiquement métaphysique.
Conclusion
Dans ce document...
Nous avons dans un premier temps présenté les structures basiques de la grille d’analyse, indépendamment des contenus d’analyse.
Nous avons dans un deuxième temps établi un pont entre l’ontophysique et certaines données fondamentales de la Physique.
Dans un troisième temps, nous avons décrit quelques postulats régissant le développement d’une analyse métaphysique, en ayant préalablement présenté les assises les plus importantes de ces postulats.
Ce document est intimement associé à deux autres documents majeurs: Binarité (Le Grand Notionnaire) et l’Intentionnalité universelle (10: métaphysique réflexive; 14: Ontophysique).
Développements
En interprétant les intentions de Greta, la compagnie a non seulement erré quant aux faits mais également quant aux valeurs en cause: il se serait agi d’une critique du service ferroviaire de la firme allemande. Or Greta, 16 ans seulement rappelons-nous, a remis les pendules à l’heure.
À l’intention de la compagnie:
Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!Loin de critiquer négativement, la garçonne sert une critique positive!
À l’intention des journalistes:
Media surprisingly seems to be more interested in a teenagers train travels than the fact that #COP25 failed.
C’est une mineure de 16 ans qui questionne les valeurs des majeur(e)s oeuvrant dans les médias. Ce fait en dit long sur la maturité de l’ado sur le plan du jugement de valeurs.
Les valeurs binaires vont comme suit:
{Cela est une valeur OU cela n’est pas une valeur} = {1 ou 0}. Si cela est une valeur, c’est alors absolument une valeur. Si cela n’est pas une valeur, ce n’est absolument pas une valeur.
Les champs d’applications sont infinis. Ils ont en commun cependant de fanatiser les personnes: hors de leurs conceptions des vraies affaires, point de vérité!
On se cause alors de valeurs rigorivistes.(1)
Ces valeurs émergent de contextes particuliers et en cela, adoptent le principe métaphysique établissant le postulat que voici:
Rien n'a de sens en dehors d'un contexte
Le sens constitue la substance, l’assise de la valeur contingentielle.
Les valeurs contingentielles n’ont rien à voir avec les absolus: le sens qu’elles véhiculent est fondamentalement et essentiellement relatif aux contextes d’où elles émergent.
On se cause alors de valeurs relativistes.
3.5 Postulats
Les postulats s’inspirent à la fois de la cybermétaphysique – inspirée de la mouvance cybernétique de 2ème génération – et de l’ontophysique – inspirée de la mouvance aristotélicienne.
L’analyse jugementielle est de type contingentiel.
3.501 Postulat
«Tout objet et sujet mentaux doivent s’avérer
en adéquation à l’objet réel».
Il est ici question du principe d’adéquation au Réel.
Par adéquation au Réel, on ne peut prétendre à ce que les objets et sujets mentaux soient identiques aux objets réels. Ces objets réels sont des choses tangibles ou des phénomènes perceptibles. Les objets et sujets mentaux sont des représentations ne pouvant exister que sur supports neurologiques. Différences radicales de nature.
L’adéquation au Réel s’inscrit dans le contexte de la déontonomie humaine. Le principe est donc tributaire de la nécessité déterminant les modes de représentations humaines et des comportements humains. Ces modes de représentations sont régis par la téléonomie, par la finalité propre des humains: la survie individuelle et de l’espèce.
Dans ce contexte, la réalité telle que représentée par l’intellect humain n’est pas le Réel dans sa plénitude mais une portion du réel correspondant aux besoins des humains.
Or une analyse réaliste ne peut emprunter un modèle binarisé. Le vrai et le faux n’existent pas dans le Réel.
Une analyse réaliste ne peut qu’adopter une approche contextuelle, donc contingentielle. L’adéquation au Réel ne peut que cibler un réel contextué.
3.502 Postulat
«Tout objet de connaissance est un icone
comportant un volet binaire et un volet contingentiel»
Nous avons établi que tout objet de connaissance est un icone doté d’un volet primaire et complémentaire. Il importe alors de déterminer la primarité et complémentarité iconiques de tout icone.
L’analyse doit cependant porter en priorité sur la substance et le contexte, donc le volet contingentiel de l’objet puisque ce volet est l’outil basique de compréhension du dit objet.
3.503 Postulat
«Tout être de nature est une entité
dotée d’une macrostructure»
Par macrostructure, on entend les structures qui permettent la configuration d’une entité.
Par entité, on entend une portion de puissance ou prototype actuée, appartenant au réel tangible.
Toute analyse doit porter sur un objet de connaissance existant en tant qu’entité. On ne peut analyser des possibles dont on ignore tout. Genre: discuter du sexe des anges! Soyons davantage explicites: analyser en profondeur des mythes fondateurs qui ne sont que fictions est à classer parmi les pertes de temps.
3.504 Postulat
«Tout être de nature est une organisation
dotée d’une infrastructure»
L’information, comportant données perçues et codes, constitue l’infrastructure de l’objet mental, lequel se définit comme une organisation de la pensée.
L’information régit également et plus fondamentalement les systèmes évoluant dans l’Univers. L’information constitue également l’infrastructure de l’Univers conçu comme organisation.
Il importe d’amorcer l’analyse initiale d’un objet de connaissance par l’étude des systèmes, processus, fonctionnements sous-jacents à l’objet réel. Les systèmes, processus, fonctionnements constituent le contexte d’un objet de connaissance dont il est question plus bas en 3.506.
3.505 Postulat
«Toute entité est un texte»
Un texte induit l’idée d’une construction par entrelacement, association, assimilation de composantes.
Un texte d’une part est le produit du tissage de composantes pour former un tout: c’est le volet texture. Les composantes incluent ce qui est perceptible par nos sensoirs mais également la substance sous-jacente à tout objet réel.
Un texte est limité par sa tessiture: hauteur, largeur, profondeur, portée, impact, etc.
L’analyse doit d’abord porter sur la tessiture d’un texte pour en déterminer les limites, la profondeur. Cette approche permet de se tenir à distance des absolutismes d’une part, d’une sous-évaluation d’autre part. Une juste analyse de la texture devrait en découler.
3.506 Postulat
«Rien n’a de sens en dehors d’un contexte»
Tout texte émerge d’un contexte. Le contexte constitue l’environnement interne et externe d’un texte.
La signifiance d’un objet de connaissance provient du texte constituant cet objet.
Le sens d’un objet de connaissance est livré par le contexte.
L’analyse du contexte doit primer sur toutes autres tâches analytiques. L’analyse d’un vocable par exemple commence par son historique avant de procéder à la validation des diverses acceptions. L’analyse d’un objet réel physique tout autant qu’appartenant à la biosphère commence par l’étude de sa morphogenèse d’une part, de son environnement actuel d’autre part.
L’analyse est d’abord quête de sens avant de s’engager dans une quête de signifiance. Ainsi doit procéder une analyse qui privilégie la contingentialité des objets de connaissance.
3.507 Postulat
«Tout Étant appartient à une catégorie»
Ci-haut, 0.209, le lien est offert vers notre article portant sur la notion de catégorie. Les chapitres 1.2 et 1.3, décrivent les notions de stéréospécificité et stéréosélectivité. Le chapitre 2.2 décrit les incompatibilités de nature. Nous allons retenir ici quelques notions pour illustrer notre propos.
Commençons par le principe logique d’incompatibilité catégoriale. Ce principe s’exprime ainsi:
Un objet
— chose ou phénomène —
ne peut être simultanément
la composante typique d’une (sous-)catégorie
et la composante d’une (sous-)catégorie autre
de même niveau que la (sous-)catégorie
dont cet objet est une composante typique.
Qu’est-ce que la stéréospécificité?
La stéréospécificité désigne une action, réaction, processus d’un agent spécifique produisant invariablement un effet spécifique.
Appliquons!
L’intelligence désigne l’activité spécifique ainsi que le produit d’un processeur humain: l’intellect. L’intelligence appartient par nature à la catégorie «biosphère», sous-catégorie «animalité», sous-sous-catégorie «humanité».
La transmission de l’intelligence est de nature stéréospécifique et non stéréosélectif.
Il est impossible que la génétique humaine puisse choisir entre transmettre cette faculté à un cerveau humain ou à un artefact électronique.
Les artefacts électroniques appartiennent à une autre catégorie d’objets, incompatibles avec l’intelligence humaine.
Généraliser l’expression «intelligence artificielle» constitue rien moins qu’une aberration logique concoctée par des cancres en matière de logique – fussent-ils et elles des doctorisé(e)s – qui se prennent pour des Igor Mel’čuk(2)! On argue qu’il s’agit d’une métaphore. Désolé pour la métaphore: elle constitue une insulte à l’intelligence réelle.
Sauf que, voyons-nous, sur la planète anthropoïde des singes, «tout le monde le dit, dites-le donc»! Alors...
Cette aberration logique n’entraîne cependant aucunes conséquences vraiment dommageables. Il n’en est pas toujours ainsi. D’où l’importance de faire ressortir les rectitudes ou errances logiques.
Quelqu’un(e) quelque part pourrait rétorquer que dans ce journel, nous pratiquons le même genre de métaphore en utilisant l’expression «bio-ordinateur cérébral». Nous y établissons donc un lien entre un artefact et un cerveau humain. Sauf que, pas pareil!
Le vocable «ordinateur» vient du latin dit impérial signifiant «qui régit, ordonne, organise». Sous la tutelle de ce processeur ou faculté qu’est l’intellect, c’est ce que le cerveau accomplit: régir, organiser, mettre de l’ordre dans les connaissances acquises.
Plus encore, ce bio-ordinateur «formate» les comportements humains pour incruster des attitudes qui deviennent permanentes et que l’on appelle en métaphysique «habitus». Il ne s’agit donc pas d’une métaphore mais d’un usage approprié du vocable «bio-ordinateur».
3.507 Postulat
«Toute Étance appartient à un Ordre de réalité»
Par ordre, on entend les manières d’être, d’agir, de se comporter, d’évoluer de tous les objets meublant l’Univers.
Ces «Étances» sont régies par ce que nous avons dénommé les «Nomies».
Ces nomies comportent quatre sous-ordres: téléonomie, déontonomie, typonomie et kinètonomie.
Typonomie et kinètonomie s’avèrent très importantes pour l’analyse de la morphogenèse des objets de connaissance.
Téléonomie et déontonomie font ressentir leurs importances dans l’étude du Droit naturel, conséquemment des droits humains.
3.508 Postulat«La réalité n’est pas le Réel»
Un dicton très fréquent, surtout en politique: «La perception, c’est la réalité». Ce n’est pas parce que ce dicton est répété par tout un chacun qu’il s’avère fondé. De fait, cette réalité à soi peut s’avérer tronquée par les préjugés, les croyances et crédulités, l’idéologie, les fictions des personnes, voire s’avérer totalement fallacieuses. Il faut donc s’entendre sur la notion de réalité.
La réalité n’est pas le Réel. Quand je pense éléphant, je n’ai pas la bête dans le cerveau. Je n’ai que la reconstitution de la configuration de la bête sous forme de représentation: image ou simulation. L’adéquation de la réalité au Réel dépend de la qualité de cette représentation. La perception mentale d’un éléphant rose suggère un problème d’adéquation au Réel...
Bref, la première qualité de la réalité est de s’avérer réaliste!
Il en est ainsi de la représentation de toutes choses et phénomènes qui crée la réalité d’un individu.
Ainsi, en décembre 2019, 54% des Britanniques opinaient que le brexit à tout prix était réaliste. 46% soutenaient le contraire. La perception serait la réalité: quelle réalité? Le P.M. Johnson ayant été réélu avec une majorité suffisante, le brexit aura lieu. Une fois consommé, sera réalité effective. Sera pour autant réaliste?
Une analyse rationnelle doit se méfier des dictons populaires... La réalité n’est pas une représentation mentale binaire mais contingentielle. Et la contingencité laisse peu de place aux absolus...
3.509 Postulat
Jugements de faits: valider les constats
Le constat est une représentation mentale objective d’un objet de connaissance lié à l’objet mental – d’où le fait qu’il soit considéré comme objectif. Le constat demeure dépendant des conditions liées à la perception de l’objet réel: états émotionnels de la personne, contextes, angles de perception, tessiture [ampleur et profondeur] de la perception [un professionnel dans un domaine va percevoir plus d’informations concernant un objet qu’un individu profane en la matière].
C’est là qu’entre en jeu l’analyse qui a pour objet l’élimination des “bruits” affectant l’information. Le jugement qui en découle tend à rétablir les faits dans une optique plus neutre. Ce point de vue est cependant celui d’un sujet pensant, donc assujetti au principe de subjectivité.
La validité et la solidité d’un jugement de fait sont tributaires de la qualité de la grille d’analyse appliquée.
3.510 Postulat
Jugements de valeurs: primarité des nécessités contingentielles
Les jugements de valeurs doivent prendre leurs assises sur les jugements de faits. Le tableau que voici:
Il est d’abord évident que si les jugements de faits véhiculent des errements – voire des aberrations, aucun jugement de valeurs ne pourra s’avérer fondé.
Des jugements de valeurs fondés doivent prendre en considération les quatre sous-ordres nomiques: typonomie, kinètonomie, téléonomie et déontonomie. L’analyse de ces nomies vont permettre d’évaluer la nature de l’objet, sa morphogenèse, son évolution, ses contraintes, ses finalités.
Cette approche est contingentielle et de nature spécifiquement métaphysique.
~ IV ~
Épilogue
Conclusion
Dans ce document...
Nous avons dans un premier temps présenté les structures basiques de la grille d’analyse, indépendamment des contenus d’analyse.
Nous avons dans un deuxième temps établi un pont entre l’ontophysique et certaines données fondamentales de la Physique.
Dans un troisième temps, nous avons décrit quelques postulats régissant le développement d’une analyse métaphysique, en ayant préalablement présenté les assises les plus importantes de ces postulats.
Ce document est intimement associé à deux autres documents majeurs: Binarité (Le Grand Notionnaire) et l’Intentionnalité universelle (10: métaphysique réflexive; 14: Ontophysique).
Développements
Les documents publiés dans le répertoire «00 Lexiques» ne fournissent que peu de références. Il s’agit de résumés de résumés de résumés de notions et concepts. Leurs objectifs est de fournir une idée globale des acceptions, notions et concepts utilisés dans ce journel.
Ces notions et concepts sont ventilés et développés dans les répertoires «Métaphysique réflexive» et «Métaphysique appliquée».
Les autres répertoires développent des thèmes dont la présente grille d’analyse en régit la rédaction.
Ces notions et concepts sont ventilés et développés dans les répertoires «Métaphysique réflexive» et «Métaphysique appliquée».
Les autres répertoires développent des thèmes dont la présente grille d’analyse en régit la rédaction.
---------------------------------------------------------------------------
1) Nous ne nous gênons pas ici pour citer des gestes et paroles de la jeune surdouée Greta Thunberg. Ce que nous admirons, ce sont son talent et son charisme exceptionnels. Une telle admiration n’implique en rien une totale adhésion à toutes ses opinions. Laisser le pétrole sous terre est aussi improbable que les accès à l’indépendance du Québec, de l’Écosse ou de la Catalogne. Il existe de telles improbabilités.
Greta est affectée (gratifiée, de son point de vue) du syndrome d’Asperger. Ces gens sont portés à porter des jugements de type binaire. Tout est blanc ou noir.
Lors de son discours à Davos, elle s’en est prise à ceux qui conteste que rien dans la vie ne peut être que blanc ou noir. C’est un mensonge, qu’elle opine. Un dangereux mensonge.
Ainsi va-t-on empêcher que ne survienne une irréversible réaction en chaîne ou on ne l’empêchera pas.
C’est blanc ou noir.
Sa vision de la crise climatique s’avère-t-elle à ce point «blanc et noir»? L’expression porte à confusion... Quand on analyse la globalité de ses interventions, elle fait montre davantage de nuances malgré les apparences.
On peut répondre par une vision tout aussi binaire: ou bien on arrête tout d’un coup sec ou on laisse aller.
Prenons l’exemple d’une auto. Un danger survient à l’avant. Ou bien on arrête d’un coup sec ou bien on n’arrête pas. Arrêter d’un coup sec, les lois de la physique vont continuer de s’appliquer: les passagers vont passer au travers du pare-brise! Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas arrêter!
Entre ces deux options, il y a freiner!
Arrêter toutes les émissions de CO2 d’un coup en laissant le pétrole dans la terre et fermant les usines, les perturbations seraient telles que des sociétés s’effondraient. En ce contexte également, un processus de freinage s’impose.
Elle a cependant raison sur quelques points: rien n’est réellement fait pour freiner le réchauffement climatique. Le néomercantilisme contemporain prônant la croissance perpétuelle et la création effrénée de richesses est une lubie qui va mener l’humanité à sa perte.
Il importe donc de mettre un terme à cette dégradation de l’environnement. «Stop» = binaire (1 / 0).
Prenant cependant appui sur le GIEC, la jeune métaphysicienne en herbe rappelle que l’on a jusqu’à 2030 environ pour FREINER l’actuelle frénésie dévastatrice. Donc, pas si radicale, la flicka!
Pourquoi métaphysicienne en herbe? Parce que ses analyses reposent sur la science!
2) Igor Mel'čuk est un linguiste canadien. Il est professeur titulaire et émérite au Département de linguistique et traduction, à l'Université de Montréal.

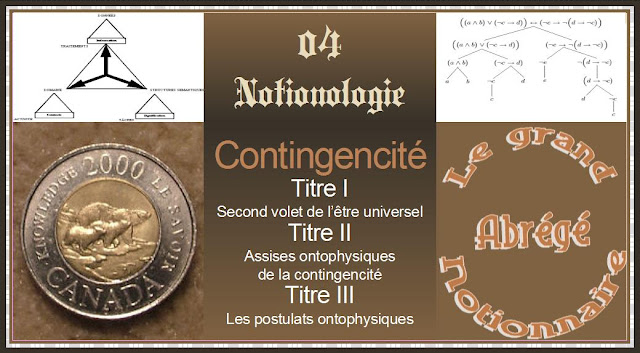




























Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Je vidange:
1) les libelles diffamatoires;
2) les attaques personnelles gratuites et/ou sans rapports avec le propos;
4) le racisme sous toutes ses formes
5) ainsi que les textes incompréhensibles parce que trop mal rédigés.
6)En passant,j'ai activé le correcteur de texte. J'apprécierais que l'on s'en serve...